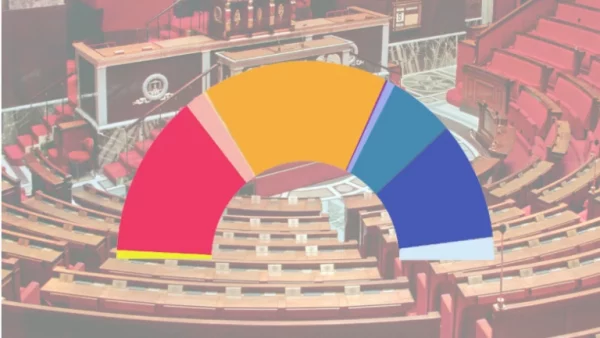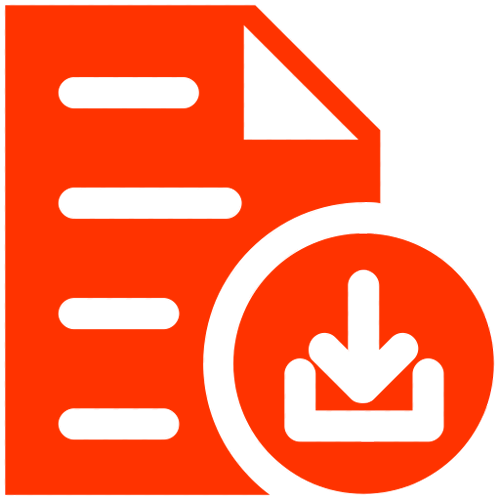Le déclin des nations est-il inévitable ?

Normalien et chercheur postdoctoral à l'Université d'Harvard, Prix Raymond Aron (2021).

Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Alexis Carré rappelle le lien indéfectible que Raymond Aron tissait entre Etat-Nation et régimes des libertés. Alexis Carré considère la nation comme un réceptacle de la délibération et un moyen d’élargir l’horizon politique.
Une première version de ce texte fut prononcée à la journée d’étude Raymond Aron du 22 juin 2023.
« Les nations européennes sont-elles vouées à la décadence si elles demeurent des nations (1) ? »
Avec un ton anodin, qui conviendrait davantage à la formulation d’un sujet de dissertation, Aron formule pourtant là ce qui fut, de son propre aveu, la question obsédante de son temps. Constatons d’emblée que, depuis sa mort, l’emprise de ladite question n’a fait qu’étendre et épaissir l’ombre qu’elle fait peser sur notre vie pratique. Si sa présence se manifeste par des signes évidents, il est, j’en conviens, un tant soit peu inexact de dire qu’elle nous pèse. C’est en effet chez nous, en Europe, là où le déclin des nations a subi sa plus forte accélération ces dernières décennies, que ce processus a suscité le plus d’espoir et été accueilli avec la plus franche alacrité. Le désaccord de l’opinion reçue avec Aron ne porte donc pas sur la question de savoir s’il y a ou non un déclin des nations, mais sur la manière dont il convient de l’apprécier. Et c’est ce désaccord qui pousse Aron à poser cette question, non pas dans des termes généraux, mais aux européens en particulier. La dissolution des nations est-elle une étape et peut-être même un passage obligé dans le grand mouvement de l’histoire européenne vers plus de progrès ou le triste symbole de notre décadence morale et politique ? Ce n’est pas en effet par fatalisme que beaucoup d’entre nous acceptent aujourd’hui la réalité de ce déclin, comme quelque chose de regrettable, certes, mais d’inévitable. Les européens accompagnèrent ce processus avec un enthousiasme que méritait selon eux de susciter cet élargissement qui leur semblait évident et bienvenu de notre horizon politique. Pour qui adopte ce dernier point de vue, l’obsession d’Aron paraît facilement être celle d’un homme inapte à se détacher d’un monde, le sien, commençant de disparaître, et encore incapable, par manque de preuves ou par excès de préjugés, d’apprécier à leur juste valeur les mérites de celui qui était alors encore en train de naître. Aron doutait de ses promesses tandis que nous vivons sa réalité. Son obsession, compréhensible alors, pour qui veut être charitable, n’aurait aujourd’hui tout simplement plus lieu d’être. Cette ligne d’argumentation, qu’on voit aussi à l’œuvre dans une certaine lecture de la réaction d’Aron aux événements de mai 68, voudrait faire de lui un penseur, certes respectable, mais finalement dépassé par les événements, et enfermé dans des conceptions que périmèrent la fin de la lutte contre le nazisme puis celle de la Guerre Froide. L’attachement d’Aron à la nation n’a pourtant rien de sentimental. Pour comprendre la question qui donne son titre à ce texte il nous faut donc, pour un temps du moins, lutter contre l’empire de l’opinion reçue et tâcher de saisir ce qu’Aron craignit de nous voir perdre en perdant la nation.
Nation et régime représentatif
L’attachement d’Aron à la nation n’est pas, comme nous le disions, de nature sentimentale — il n’est pas non plus essentiellement esthétique. S’il faut craindre le déclin des nations c’est précisément pour lui parce que l’existence de cette forme moderne de l’amitié civique fut indissociable de l’émergence des régimes libres et demeure indispensable à leur maintien. Ce qui semble être en jeu dans la nation pour Aron, c’est moins une particularité de style, une culture ou un folklore, qu’une certaine qualité de l’agir et du langage humain, qui par les rapports qu’elle établit entre certains hommes permet à ces derniers de se gouverner eux-mêmes. Constatable par la raison naturelle, elle est non seulement un élément essentiel à la compréhension de notre régime mais également une réalité politique sans laquelle le fonctionnement de nos institutions serait en réalité menacé :
« Les régimes démocratiques n’ont pas pour fonction de créer les États ou l’unité des nations ; ce qui est possible, c’est que l’unité des États et des nations résiste à la compétition permanente des hommes et des idées. On n’a jamais créé une nation en disant aux hommes : allez et disputez-vous. Parfois, l’Occident semble conseiller aux pays libérés de faire sortir le pouvoir de leurs divisions. » (2).
Une science politique qui choisit d’ignorer cette réalité aggrave ainsi les difficultés qu’elle prétend résoudre. En se contentant de penser l’État comme l’institutionnalisation des divergences d’intérêts et d’opinions présents dans la société, elle accentue les conflits qui en découlent, mais empêche aussi ladite société de se constituer en pouvoir, en une capacité d’agir collective. Il dit ailleurs :
« Pour dire les choses autrement, un système de compétition pacifique suppose l’existence de l’État, l’existence d’une nation. Un des signes les plus étonnants aujourd’hui de l’inculture politique est l’idée, extrêmement répandue que, quand il n’existe pas encore d’État, on peut le créer et qu’on peut le créer par des procédés démocratiques. » (3).
En effet, nous tendons promptement à attribuer beaucoup des mérites de notre mode de gouvernement au pluralisme des sociétés libérales, et c’est en son nom que l’on se réjouit du dépassement de la nation et, à travers elle, de l’intolérance et de l’exclusion dont elle serait la source. Or, pour Aron, le pluralisme libéral ne saurait produire les effets bénéfiques que l’on attend de lui, la compétition pacifique, à moins d’agir sur une communauté d’hommes qui ne veulent pas être séparés et pour lesquels existent des principes de commandement légitimes. C’est parce que ces hommes veulent vivre et partager un même commun que leurs désaccords suscitent en eux, non pas le désir de se séparer, de se soumettre ou de se détruire les uns les autres, mais celui de se convaincre en vue d’agir ensemble, c’est-à-dire de donner à l’autre des raisons susceptibles de gagner son approbation, son concours et même sa libre obéissance.
Sans présupposer cette force contraire qu’est l’amitié civique, et l’existence d’une hiérarchie d’agents et de fins, les mêmes différences d’opinions et d’intérêts que nous avons coutume de célébrer engendraient au contraire une défiance et une hostilité qui rendraient impossible le fonctionnement de notre régime. La « disparition légale des rangs et des conditions » à laquelle Aron associe l’émergence de la démocratie libérale ne signifie donc pas pour lui l’abandon de tout principe hiérarchique ou de toute notion de bien commun. Elle permet au contraire de dissocier dans une certaine mesure la minorité qui dans tout régime concentre les fonctions de commandement de celle qui dans toutes société concentre les ressources et les moyens d’influence. Cette classe politique et dirigeante peut se libérer de l’étreinte des « socialement puissants » et asseoir son autorité parce qu’elle se soumet à la nécessité livrer publiquement des raisons d’agir en commun et ne le peut humainement et sans trop de risque que parce qu’existe cette amitié entre celui qui commande et celui qui obéit, unité supérieure sans laquelle la division des élites risquerait d’entraîner l’exploitation ou la guerre civile.
Le libéralisme et ses ennemis
Aron rejette donc l’idée qu’il suffise que l’homme soit libre et sans attaches, les institutions neutres et la société diverse pour que l’existence du régime libéral soit garantie. Ceci ne fut pas, comme on le dit parfois, une inflexion tardive, républicaine ou pessimiste, dans la pensée d’Aron. Dès 1939, dans un discours prononcé à l’aube de la guerre devant la Société Française de philosophie, il déclare en effet :
« L’optimisme politique et historique du XIXe siècle est mort dans tous les pays. Il n’est pas question aujourd’hui de sauver les illusions bourgeoises, humanitaires ou pacifistes. Les excès de l’irrationalisme ne disqualifient pas, bien au contraire, l’effort nécessaire pour remettre en question le progressisme, le moralisme abstrait ou les idées de 1789. Le conservatisme démocratique, comme le rationalisme, n’est susceptible de se sauver qu’en se renouvelant » (4).
Loin de fournir une justification à la philosophie du progrès, les excès du pessimisme anthropologique et de sa concrétisation politique dans l’Allemagne hitlérienne confirmèrent dès les années 30 pour Aron la nécessité d’en penser la critique, non pas certes afin de remettre en question le régime libéral qui s’en réclamait mais au contraire en vue de le renouveler.
Ce qu’Aron réalise lors de son séjour en Allemagne et à l’approche de la guerre, c’est qu’il est vain de penser notre régime à partir d’une conception vide ou négative de la liberté qui évacue la perspective de l’agent lui-même. Penser la politique à partir de cette idée de liberté c’est en effet abandonner tout possibilité pour les motifs que poursuivent les hommes quand ils agissent de constituer le fondement d’un commandement — c’est-à-dire d’une obligation ou d’un devoir (si le motif est bon, il doit valoir pour les autres) et d’une autorité chargée d’en demander et d’en obtenir le respect et l’accomplissement (il me revient ou à quelqu’un d’autre de m’assurer qu’on le poursuive). Dans le cadre de cette philosophie du progrès la justification des contraintes devient alors purement extérieure. Il ne s’agit plus de rapports concrets, du commandement de certains hommes sur certains autres et des raisons qu’ils partagent ou ne partagent pas, mais d’institutions dont la structure et l’étendue se fondent désormais, non pas sur les questions que je me pose quand j’agis (puisqu’aucun de mes motifs ne m’autorise à l’imposer aux autres hommes), mais sur le comportement des hommes en général, sur la façon dont ils usent de leur liberté. L’anthropologie, la question de savoir si l’homme en général est bon ou mauvais, détermine dorénavant la nature du régime souhaitable (libéral et paisible dans le premier cas, autoritaire et violent dans le second). Les tenants de la première hypothèse, parce qu’ils la pensent naïvement portée par le courant de l’histoire, rendent les choix pratiques et moraux indifférents : les hommes en apprenant à user de leur liberté sans empiéter sur celle des autres peuvent vivre en paix. Ceux de la seconde, parce qu’ils ne voient qu’une histoire pleine de bruit et de fureur abolissent la possibilité de tout jugement pratique ou moral au profit d’une métaphysique irrationaliste de la volonté qui justifie selon eux l’assujétissement d’un homme naturellement mauvais, ou dangereux, c’est-à-dire sans loi, à un pouvoir sans limite. Or Aron, le perçoit bien, les partisans de l’optimisme anthropologique sont incapables de comprendre la guerre qui vient et de justifier les sacrifices que rendra bientôt nécessaire l’hostilité des nihilistes qui rejettent et condamnent l’idéal de civilisation.
Nation, devoirs et rationalisme politique
Et c’est dans l’idée de nation qu’il trouve la possibilité d’une réaffirmation de la primauté des devoirs qui ne soit pas incompatible mais au contraire favorable à l’existence d’un régime libre (5). Dans ce régime, fondé sur la primauté des droits, le type d’amitié qui lie les membres d’une même nation devient le véhicule indispensable et effectif de nos obligations et de notre rationalité pratique. Indispensable parce que, sans cette force, le régime des droits se dissout sous l’effet de ses propres forces centrifuges, et effective, car c’est du fait du bien que constitue cette amitié que notre société, par le seul spectacle de son fonctionnement, suscite en nous le désir d’y participer, non du fait des intérêts dont la protection l’exige, bien que ces raisons existent, mais parce que la participation à la vie nationale en elle-même nous apparaît comme un bien d’un type particulier dont nous souhaitons jouir et dont nous ne pouvons jouir que par cette existence commune. C’est, non en vue de droits abstraits, mais de ce bien dont la conservation et la poursuite définissent pour les membres d’une nation une vie digne d’être vécue, que l’on peut rendre compte de leur détermination à la sacrifier plutôt que d’en être privés. Et c’est en l’absence de ce bien que nos passions, réduites à celles qui occupent nos vies d’individus, cessent de fournir son ressort à la résistance que toute collectivité oppose à ceux qui cherchent à la soumettre :
« La morale du citoyen, c’est de mettre au-dessus de tout la survie, la sécurité de la collectivité. Mais si la morale des Occidentaux est maintenant la morale du plaisir, du bonheur des individus et non pas la vertu du citoyen, alors la survie est en question. S’il ne reste plus rien du devoir du citoyen, si les Européens n’ont plus le sentiment qu’il faut être capable de se battre pour conserver ces chances de plaisir et de bonheur, alors en effet nous sommes à la fois brillants et décadents » (6).
En admettant ceci, nous aurions à la rigueur établi que le déclin des nations équivaut à toutes fins utiles à un changement de la nature de notre régime, mais nous n’aurions pas exclu la possibilité que ce changement convienne à l’air du temps. La pacification des relations entre États ne rendrait-elle pas superflus, avec la menace de la domination, le souci de l’indépendance et la nécessité de se battre pour la conserver ? Ce changement de la nature de notre régime ne serait-il pas aussi rendu nécessaire en vertu d’une contradiction interne à la démocratie libérale qui tendrait à la faire sortir de la forme politique qui l’a vue naître ? C’est ce que semble penser celui que l’Europe nouvelle est le plus près de s’être donnée pour penseur. Loin de nier les liens qu’établit Aron entre la nation et la préservation d’un commandement politique moralement exigeant, Jürgen Habermas souscrit à cette connexion pour immédiatement la condamner :
« Il existe une discordance remarquable entre les traits quelque peu archaïques des “obligations potentielles”, assumées par ceux qui partagent un destin commun et sont prêts à faire des sacrifices les uns pour les autres, et la conception normative qu’ont d’eux-mêmes les sujets de droit librement associés dans l’État constitutionnel moderne. […] Or, une telle image s’accorde mal avec la culture des Lumières, dont le cœur normatif consiste à abolir toute morale en vertu de laquelle un quelconque sacrifice serait publiquement exigé. […] À la différence de ce qui prévaut en morale, en droit positif les obligations sont secondaires. […] Sous de telles prémisses, il est de toute façon impossible de justifier le service militaire obligatoire ou la peine de mort » (7).
On le voit ici, c’est bien le sentiment d’obligation, que le désir d’unité de ses membres rend la nation capable de produire chez ces derniers, que l’on vise à épuiser au travers du dépassement de cette dernière, et ceci, non en vue de quelque dessein volontairement pernicieux, mais afin de réaliser pleinement la possibilité, contenue dans les droits de l’homme, d’une existence individuelle parfaitement autonome. La tentative de dépasser la nation en Europe ne fut donc pas seulement une conséquence malheureuse et inattendue de la politique des droits de l’homme, mais envisagée consciemment comme une condition de sa réalisation pratique. Cette tentative ne pouvait néanmoins réussir que si ce dépassement aboutissait à une progressive pacification des relations entre États aboutissant à une forme plus ou moins achevée de société globale où, la menace de la domination ayant laissé place à la coopération pacifique, disparaissait avec elle le souci de l’indépendance.
Comme les plus myopes esprits le constatent aujourd’hui, la régulation des relations entre États a peut-être diminué certaines incertitudes, surtout économiques, mais elle n’a pas fondamentalement changé la nature des menaces et des risques politiques propres à l’ordre international. L’entêtement avec lequel les Européens entretiennent leur ignorance collective de cette réalité ne saurait s’expliquer que par notre désir de réaliser le projet dont elle excluait pourtant la possibilité. Aron touche néanmoins aux raisons qui donnèrent à cet espoir un ascendant pour ainsi dire irrépressible sur notre vie morale et politique.
Épuisées et dégoutées d’elles-mêmes par deux guerres mondiales, les nations d’Europe entrèrent dans la Guerre Froide avec le sentiment aigu et nouveau de leur faiblesse. Ce continent qui, réalisant la prédiction de Kant, avait jusqu’alors donné ses lois au monde se retrouvait soudain composé d’États-nations, dépouillés de leur empire, et incapables de concurrencer les deux Grands. Le rêve d’un monde sans guerre et d’une vie sans obligation s’empara des nations d’Europe parce qu’il adoucissait et répondait exactement à la perspective de leur impuissance.
Mais si le déclin matériel des « nations de petits espaces » est indéniable, rien n’indique selon Aron que leur décadence politique et morale s’ensuive mécaniquement de cette première constatation. En premier lieu parce que la supériorité de ce qu’il appelle les « peuples de grands espaces » (il dénombre à cette époque États-Unis, Union Soviétique, Chine et Inde) est inégale, faillible et contestable. Et les 60 années qui suivirent la rédaction de Paix et guerre ne confirment-elles pas que ces grands États perdirent souvent leurs moyens, aussi supérieurs fussent-ils, contre des adversaires incomparablement plus faibles ? Parce que l’histoire ne suit pas des lois mécaniques qui les condamnerait à l’avance et pour le simple fait que le dépassement des nations fut en Europe le produit d’une décision consciente, et non d’une fatalité imposée de l’extérieur, il ne saurait nous apparaître comme inévitable.
En fournissant son ressort passionnel à l’échange public des raisons, la nation et l’amitié politique qu’elle rend possible entre les hommes, sont ce qui transfigure la compétition permanente des hommes et des idées, le désir de commandement et les désaccords sur le juste et l’injuste, de cause de violence en source de vie civique, de guerre des dieux en espoir de réconciliation et d’unité. Parce qu’elles mobilisent le désir qu’ont naturellement les hommes de vivre en commun, les nations permettent à leurs membres de délibérer à propos de plus de choses concernant lesquelles ils sont en désaccords, plus de choses dont ils ont besoin de se convaincre les uns les autres et, pour cela, de fournir leurs raisons. Elles élargissent plus qu’elles ne rétrécissent l’horizon politique des buts que nous pouvons collectivement poursuivre. En cela, elles sont une source de force et d’action en dépit même d’une faiblesse matérielle dont Aron nous rappelle que nous aurions tort de nous désespérer. Le monde qui s’annonce a de toute façon peu de chance de nous laisser le luxe de nous en priver, fût-ce pour cultiver notre jardin.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI
Sources :
- (1) R. Aron, 1962, Paix et guerre entre les nations, Paris: Calmann Lévy, 2004, p. 317.
- (2) Nicolas Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, Tempus, 2006 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexion politique, Julliard, 1983 Raymond Aron, L’Opium des intellectuels, Calmann-Lévy, 1955
- (3) R. Aron, Introduction à la philosophie politique, Paris, Éditions de Fallois, 1997, p. 85.
- (4) R. Aron, « États démocratiques et États totalitaires » in Commentaire, vol. 24, no 4, 1983, p. 702.
- (5) La question de savoir s’ils appartiennent à un même peuple est déterminante dans le fait que les hommes s’accordent ou se refusent, trouvent digne ou indigne de commander ou d’être commandés les uns par les autres. C’est pour avoir reconnu cette évidence qu’Aron fut un des partisans précoces de l’indépendance de l’Algérie. Voir R. Aron, 1962, Paix et guerre entre les nations, Paris: Calmann Lévy, 2004, p. 325.
- (6) R. Aron, Le spectateur engagé, Paris : Éditions de Fallois, 2004, p. 413.
- (7) Jürgen Habermas, Après l’État-Nation. Une nouvelle constellation politique, trad. Rainer Rochlitz, Paris : Fayard (pluriel), 1998, p. 110 sq.