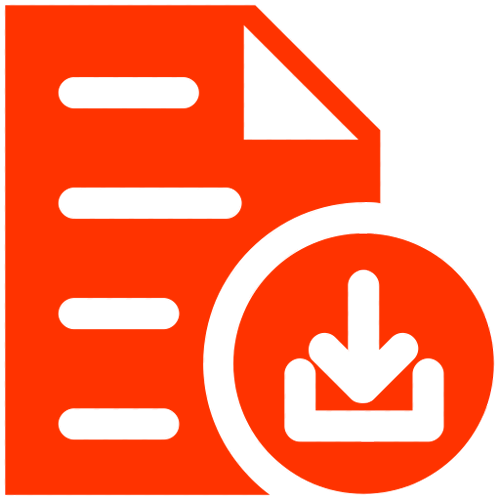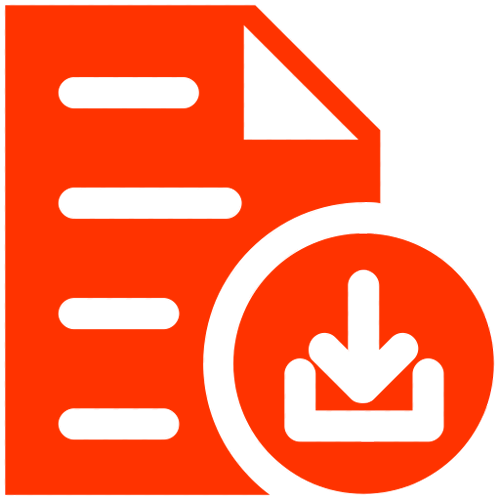
Dans une chronique de Libération parue en 2018, la professeure d’économie à l’université de Pennsylvanie, Ioana Marinescu, développait les avantages du dividende carbone proposé par trois députés de Floride pour lutter contre le réchauffement climatique.
En décembre 2018, la taxe sur les carburants proposée par le gouvernement de l’époque déclenchait en France le plus grand mouvement social depuis des décennies : la crise des gilets jaunes. 4 ans après, dans un contexte d’aggravation des bouleversements climatiques et alors que la guerre en Ukraine entraine une inflation record sur le prix de l’énergie et donc des carburants, l’article de Ioana Marinescu apparaît plus que jamais d’actualité.Si les acteurs et le contexte cités par la professeure en économie ont changé, Donald Trump n’est plus Président et les États-Unis sont revenus dans l’accord de Paris sur le climat, la nécessité d’engager des réformes structurelles afin d’opérer une transition énergétique n’a quant à elle pas disparu.
« La taxe carbone découragerait les émissions de carbone alors que le dividende compenserait les ménages pour la hausse des prix. Une telle politique de dividende pourrait permettre au gouvernement français de combattre le changement climatique tout en étant sensible aux protestations de la population contre la cherté des carburants. »
Ainsi, trois députés américains de l’État de Floride soutenus par des élus des deux camps – républicains et démocrates – proposaient la mise en place d’une taxe carbone redistribuée sous forme de dividende aux ménages américains. Le consensus politique trouvé sur cette mesure par des élus pourtant opposés dans bon nombre de domaines de la vie politique américaine, se trouve dans la conciliation de deux objectifs majeurs. Si les démocrates y voient un formidable moyen de lutter contre le réchauffement climatique, de leur côté, les républicains applaudissent l’absence d’entrave et de contraintes portées sur les entreprises américaines.
Afin de protéger les ménages américains contre les changements induits par cette taxe, les revenus qu’elle génèrerait leur seraient redistribués sous forme d’un dividende carbone, soit un chèque égal pour chaque Américain. Selon les projections du Trésor Américain, ce dividende protégerait 70% des ménages contre la hausse des coûts liée à l’entrée en vigueur de la taxe carbone. Les ménages les moins lotis – les 10% les plus pauvres – verraient leurs revenus augmenter de 9%.
« Même si la taxe carbone a encore du chemin à faire aux Etats-Unis, l’idée du dividende pourrait aider la France à avancer sa politique de lutte contre le changement climatique. Si l’augmentation de la taxe sur les carburants servait à augmenter les revenus des Français les plus modestes, l’objectif de lutte contre le changement climatique ne serait plus en opposition avec la justice sociale. »
Pour l’économiste, tout l’intérêt de cette taxe réside dans l’absence de condition préalable pour percevoir ce dividende ainsi que dans sa liberté d’usage pour les individus. Une simple mesure compensatoire sur la hausse des coûts du carburants – l’octroi d’une réduction conditionnée à une consommation d’un certain coût de carburant – n’incite pas les individus non concernés à se mettre au diapason d’un objectif de réduction des émission.
Pour lire l’article original paru dans Libération, cliquer ICI.
Publié le 02/06/2022.
Dans L’Opinion, l’économiste Thierry Aimar prône le retour au subjectivisme libéral pour en finir avec l’individualisme communautaire.
Alors que les concepts libéraux sont efficients pour penser l’économie dans son ensemble, Thierry Aimar déplore qu’il n’en soit pas de même pour analyser la montée du communautarisme. Le récit commun voudrait que nos sociétés soient gangrenées par l’individualisme. Il n’en est rien. Ce que constate l’économiste est au contraire l’avilissement de l’individus soumis à la prolifération de communautés. Celles-ci ont pris un tel poids dans l’espace public qu’il devient impossible de ne pas s’identifier à l’une d’entre elles et de refuser de se conformer à ce qu’elles dictent. Les individus ne peuvent parvenir à trouver leur subjectivité intrinsèque par crainte d’être brimés et s’en remettent aux communautés pour se forger leur identité.
« D’un point de vue économique, l’obsession de la conformité, la dictature de l’opinion collective sont des chapes de plomb qui pèsent sur nos esprits. Les gens ne réfléchissent plus, ils reflètent. »
Trop souvent analysé à l’aune du fait religieux, le communautarisme essaime dans toutes les sphères de la société. Les railleries laïcardes qui incantent la liturgie républicaine et souverainiste pour s’opposer au communautarisme religieux ne sont que la face opposée d’une même pièce. Un communautarisme contre un autre. Les communautarismes religieux, de genre ou d’État procèdent tous de la même façon avec une seule et même conclusion : la négation de l’individu.
Le phénomène victimaire unit socialement des personnes qui n’avaient jusqu’alors jamais désiré faire communauté. L’économie de marché subit ce contrecoup. Les échanges ne se fondent plus sur les interactions subjectives et sur un intérêt mutuel réciproque mais sur le rapport de force institué par ces communautés puissantes auxquelles s’agrègent des individus pour en tirer des bénéfices sociaux, économiques et moraux. Formatés, les individus ne cherchent plus à s’émanciper individuellement mais s’aliènent aux dikats idéologiques du groupe en perpétuant une pensée autoréférentielle qui se conforte dans ses propres préjugés.
« Le goût des marques, des signes extérieurs de richesse ne reflète rien d’autre qu’un désir de se catégoriser socialement et d’afficher son appartenance à une certaine communauté, celle des riches. L’individualisme libéral est étranger à tout cela. Il est fondé sur la recherche de singularité, de parcours diversifiés qui permettent à une société de l’échange de se développer.»
Pour contrer ce phénomène, Thierry Aimar propose d’en revenir à l’exaltation d’une culture subjective à même de révéler à l’individu ce qu’il est vraiment, indépendamment du poids que la communauté cherche à lui faire porter. Ce voyage intérieur, que l’économiste nomme « introprenariat », est source de créativité et d’innovation. Plus encore, il est un prérequis pour créer de la valeur et échanger avec autrui.
Pour lire l’article dans L’Opinion, cliquer ICI.
Publié le 16/05/2022.
Dans L’Express, la féministe libérale Mathilde Berger-Perrin analyse la polémique sur l’autorisation du burkini dans les piscines grenobloises. Elle appelle à dépolitiser le vêtement féminin.
Notre bonne, vieille et douce France n’est pas avare en polémiques d’apparence risible. La dernière en date ? L’autorisation pour les femmes décrétée par Eric Piolle, maire de Grenoble, de porter un burkini dans les piscines de la ville. Mathilde Berger-Perrin rappelle que chez nos voisins allemands, à Göttingen, les femmes ont désormais le droit de nager seins nus en raison de l’égalité hommes-femmes et sans qu’une once de voix protestataire ne se soit élevée pour fustiger cette disposition.
« Tout comme je ne pense pas qu’une femme en bikini soit automatiquement une victime du patriarcat, je ne penserai pas que le burkini soit nécessairement le signe d’une domination masculine. Pourquoi ? Parce que je me refuse de penser à la place des autres. »
Doit-on voir là une forme de progrès social comme le prêche une frange du mouvement féministe (près de cent associations féministes se prononcent publiquement pour son autorisation) ? ou serait-ce le retour d’un obscurantisme clérical (il ne faut pas oublier que dans de nombreux pays le refus du port du voile est passible de la peine de mort) ? Pour Mathilde Berger-Perrin, on ne peut juger des intentions d’autrui sans risquer d’ouvrir la voie aux politiques totalitaires. Que le port du burkini soit contraint par la pratique religieuse intra-familiale ou qu’il soit un affichage identitaire, ce que l’essayiste regrette dans les deux cas, la puissance publique ne peut interdire aux individus de disposer librement d’eux-même au motif de leur intentions mais plus encore lorsqu’ils ne représentent aucun danger avéré. La jeune essayiste nous rappelle avec intelligence que personne n’a le monopole ni la même définition de la pudeur dans notre pays et que c’est là un point essentiel qui nous différencie des régimes autoritaires.
« Au nom du féminisme, militons pour que chacune puisse porter ce qu’elle veut. Défendre ou interdire un vêtement féminin, c’est mimer les pratiques des cultures oppressives. Il est surtout temps que le vêtement féminin ne soit plus politique. »
Déplorer le port du burkini est une chose, mener une croisade néfaste pour l’interdire en est une autre. Pour Mathilde Berger-Perrin, jamais ce genre de polémique n’aurait eu lieu dans le cadre d’une piscine privée définissant ses propres règles. En médiatisant ouvertement l’autorisation du birkini à des fins électoralistes et pour s’offrir un affichage politique de grande envergure, les politiques élus, à l’instar d’Éric Piolle, alimentent un capharnaüm désobligeant.
Afin d’en finir avec ce retour insidieux des lois somptuaires, Mathilde Berger-Perrin appelle à dépolitiser le vêtement féminin pour qu’enfin les femmes cessent d’être soumises à l’approbation de leurs congénères masculins.
Pour retrouver le billet dans L’Express, cliquer ICI.
Publié le 13/05/2022.
Dans Ouest-France, Jacques Toubon revient sur le recul des libertés publiques dans le monde depuis quelques décennies. Pas fataliste, l’ancien ministre et Défenseur des droits voit dans le projet européen un moyen pour lutter contre les idéologies liberticides.
Pour Jacques Toubon, le recul des libertés publiques débute avec les attentats du 11 septembre 2001 lorsque les Américains ont le choix de privilégier la sécurité au détriment de la liberté en adoptant le « Patriot Act ». Cependant, se remémorant les premières lois antiterroristes de 1986 et l’attentat survenu dans le RER B en 1995 alors qu’il était Garde des Sceaux, Jacques Toubon rappelle que le choix de la sécurité préventive sur les libertés publiques n’est pas la seule option. Ainsi, le législateur français avait « veillé à ne pas créer un cadre d’exception » en maintenant la nouvelle juridiction contre le terrorisme qui avait été créée dans les principes de la procédure pénale.
« Nous avons franchi le pas avec nos états d’urgence antiterroriste, puis sanitaire, oui. Une de mes grandes préoccupations est de voir que la loi du 31 octobre 2017 sur la Sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme – la fameuse loi « Silt » – a traduit dans le droit commun quatre dispositions de l’état d’exception. En les accommodant avec des règles de procédure, certes, dont l’intervention d’un juge, mais tout de même. Le droit pénal n’est pas fait pour prévenir. On ne peut pas incriminer avant que l’infraction ne soit commise. »
S’il ne peut admettre le qualificatif de « dictature sanitaire », estimant que l’état d’urgence a été promulgué dans le respect du droit, de la Constitution et des institutions, il craint que les états d’urgences qui se succèdent – état d’urgence terroriste puis sanitaire – n’aient ouvert une boîte de Pandore liberticide.
À cela, s’ajoute la prolifération intercontinentale des idéologies identitaires. Qu’ont en commun Jaïr Bolsonaro, Viktor Orban ou Éric Zemmour ? De prospérer sur une idéologie antilibérale qui, outre ses aspérités biens connues – xénophobie, racisme -, sacrifie les libertés au nom de la sécurité, le tout dans une parfaite dérive autocratique du pouvoir.
« La Hongrie ou la Pologne sont parvenues à installer des systèmes qui bafouent le droit et les libertés en s’appuyant sur le suffrage universel. Forts des majorités qu’ils obtiennent aux élections, leurs dirigeants tiennent leurs valeurs identitaires pour supérieures aux valeurs universelles des grands textes de l’Union Européenne. On parle de « démocratie illibérale » à leur propos, mais la formule « autocratie élective » me paraît meilleure. »
Jacques Toubon voit dans l’Union Européenne le bon échelon pour endiguer cette peste antilibérale. Il rappelle que « depuis le 1er janvier 2022, un pays qui refuse de respecter les valeurs de l’Union européenne peut se voir priver de financements ». S’il est impossible de se réjouir d’une crise meurtrière, l’ancien Défenseur des droits estime que le conflit ukrainien a le mérite de sortir l’Europe de son apathie. Pour triompher des idéologies illibérales, l’Europe doit diffuser une culture humaniste et libérale. À ce titre, Jacques Toubon rêve d’un sorte d’Erasmus de la culture et de l’éducation qui concernerait tous les élèves de l’Union dès le collège. Chaque année serait marquée du sceau d’un artiste européen, figure de ces nobles valeurs à défendre, pourquoi pas l’année Érasme, Shakespeare, Goethe, Dante ou encore Tchekhov ?
Pour retrouver l’entretien dans Ouest-France, cliquer ICI.
Publié le 02/05/2022.
Dans Atlantico, l’économiste Pierre Bentata estime que le libéralisme, à rebours des préjugés qui l’opposent au social, est l’idéologie qui fait advenir dans les faits, les progrès sociaux.
Opposer la pensée libérale et la question sociale comme le font trop de commentateurs politiques de nos jours est un contresens historique selon Pierre Bentata. Avant de s’intéresser à l’économie, les libéraux se sont d’abord intéressés à conceptualiser l’émancipation des individus des tutelles politico-religieuses – du clergé et de la monarchie – en vertu de l’égalité entre les hommes.
« Les premiers philosophes à s’opposer à la colonisation, à l’esclavage, au servage, qui vont demander la légalisation des corporations, des syndicats, etc. ce sont toujours des libéraux. L’aspect social est fondamental dans la pensée libérale. »
Cet antagonisme absurde réside dans l’inculture française à l’endroit du libéralisme. En cause, des spécificités historiques nationales. Tout d’abord, la France est un pays davantage ancré dans la terre que tourné vers la mer. Pourtant, comme l’a théorisé Montesquieu, le commerce international n’est pas pensé par les libéraux à l’aune du profit et de l’enrichissement immodéré mais bien en tant qu’ouverture sur le monde, ouverture à l’altérité, dans une perspective d’apaisement des mœurs et de plus grande tolérance.
Le deuxième facteur explicatif ayant résulté sur cette fausse opposition se retrouve dans les conditions d’enseignements du libéralisme par les instances socialisatrices. À en juger par la consécration actuelle d’hussards noirs antilibéraux au sein de nos universités et dans nos grandes écoles, il n’est guère étonnant, pour Pierre Bentata, que le libéralisme soit frappé d’anathèmes. Avec son surgeon néolibéral, le libéralisme est associé dans l’univers mental français à l’égoïsme et la perfidie en dépit de ce qu’on bien pu écrire les philosophes libéraux français.
Personne n’a en mémoire que Jean Baptiste Say, penseur libéral, est le premier à avoir chiffré le coût de l’esclavage et démontré que la pratique s’avérait inefficace et mauvaise alors même que les arguments moraux les plus tenaces ne suffisaient pas à en faire cesser la pratique. Personne n’a en mémoire que Frédéric Bastiat est l’un des premiers à avoir défendu les pauvres gens. En somme, pour Pierre Bentata, « tout ce qui fonctionne dans le libéralisme, n’est pas du libéralisme et tout ce qui dysfonctionne est du libéralisme à combattre ».
« La création des institutions internationales, la levée des barrières douanières, la décolonisation, sont obtenues lorsque le monde entre dans cette période tant détestée qu’on appelle la globalisation. La conséquence de cela, c’est l’effondrement de l’appauvrissement, une croissance économique qui n’a jamais été aussi importante, c’est une amélioration de la santé, une facilitation de la vie des individus. Tels sont les résultats de la pensée libérale. »
Le nouveau clivage à l’œuvre est entre les partisans des Lumières et les anti-lumières, soit entre les libéraux et les collectivistes, ceux qui prônent l’ouverture et ceux qui se fourvoient dans la nation et la dénonciation calomnieuse du mythe global. Triste ironie de l’histoire que de voir les anti Lumières se prévaloir d’être les fers de lance de la pensée sociale.
Pour retrouver l’entretien dans Atlantico, cliquer ICI.
Publié le 24/04/2022.
Dans Le Figaro, la philosophe Julia de Funès estime que la morale invoquée pour voter untel plutôt qu’un autre est vaine en ce que le raison ne prédomine jamais tout à fait sur la passion.
Pour Julia de Funès, les prises de paroles médiatiques appelant à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle en raison de la reductio ad hitlerum faite à Marine Le Pen empêche de penser le présent et sa complexité. Derrière ces appels à l’opinion publique se cacherait une posture matamoresque consistant à dire le bien et le mal en se positionnant nécessairement du côté du premier .
« Plus le monde devient complexe et plus les esprits pauvres en lucidité mais riches en moralisation se cramponnent aux époques où il y avait d’un côté le mal, de l’autre le bien. »
En effet, selon la philosophe c’est surestimer le pouvoir de la morale sur les consciences que d’espérer que son invocation suscite des retombées électorales significatives. Qui donc a déjà arrêté de fumer après des sermons moralisateurs ? Pour la philosophe « seul un désir peut en contrer un autre, de sorte que le match raison versus passion se termine généralement mal pour la rationalité souvent perdante ».
Ensuite, il ne faut pas oublier qu’opposer des arguments rationnels n’est en rien une option adéquate pour attester du bien fondé d’un vote sur un autre. Axiologiquement la raison ne sert pas à distinguer le bien et le mal mais à discerner le vrai du faux.
« Un acte libre, comme l’est un choix électoral, suppose de se laisser déterminer par sa propre volonté. »
Enfin pour terminer sa démonstration sur le caractère inefficient de la morale en cette période électorale, Julia de Funès rappelle que la délibération suit la prise de décision et non l’inverse. Les citoyens ont déjà pour beaucoup faire leur choix et donc pris leur décision. La délibération qu’ils opéreront ne se fera qu’en miroir de cette décision contrairement à ce que pense « les prédicateurs ». Dès lors, pour la philosophe et au nom de l’essence même jeu démocratique à bulletin secret, il faut laisser les individus exprimer leur vote librement.
Pour retrouver l’entretien dans Le Figaro, cliquer ICI.
Publié le 19/04/2022.
Dans Le Figaro, l’ancien ministre Jean-Louis Borloo présente son manifeste pour la création d’un Conseil national de la République afin de réorganiser efficacement les compétences et les responsabilités.
Sorti du sérail, c’est en tant qu’observateur engagé de notre vie politique que Jean-Louis Borloo prend la plume. Constatant l’urgence politique du moment, il signe un manifeste de 95 pages intitulé « l’Alarme ». Face au délabrement du service publique, à la montée de la radicalité, à la colère grandissante de nos concitoyens, il propose sa méthode pour une nouvelle « union nationale ».
« Nous sommes restés sur cette nostalgie, mais, soixante-dix-neuf ans plus tard, après tant de bouleversements (l’Europe, l’euro, les régions, le syndicalisme, l’action sociale et la révolution numérique…), il est temps de rebâtir tranquillement nos fondations. Je ne propose pas de nouvelles mesures mais une réflexion sur l’organisation selon une juste répartition claire et efficace des responsabilités et des compétences. »
Pour Jean-Louis Borloo, il est vitale afin de maintenir la cohésion nationale, de susciter une coalition d’acteurs faite de membres de la société civile, de parlementaires et de l’exécutif, sur six sujets cruciaux ciments de notre unité : Justice, ordre, jeunesse, santé, habitat, environnement. Pour accréditer ses dires, il se fie aux expériences réussies de coalitions mises en place afin de développer économiquement son territoire du Valenciennois.
L’inertie actuelle est selon lui ancrée dans notre imaginaire politique qui se conforte dans ses habitudes et s’épouvante à l’idée du changement. L’état de développement du pays n’est pas moins mauvais qu’ailleurs, il juge que nos élites sont bien formées, que notre monnaie est solide, pour autant l’organisation de l’action publique s’enraye sans que quiconque à bord de la machine ne pense à regarder le moteur.
« Nous ne sommes plus un État centralisé, mais pas non plus un État décentralisé. Nous sommes dans un système d’hybridation, c’est-à-dire de doublons et de confusions. D’ailleurs, je vois la Corse comme l’illustration des grandes difficultés entre l’État central et les régions, que je mentionne dans ce manifeste. »
La coalition, qu’il présente comme un Conseil national de la République, trouve son origine dans le Conseil national de la Résistance. À l’image de celui-ci, il s’agit pour Jean-Louis Borloo de crée un organe capable d’identifier les principaux objectifs de la nation et d’affecter intelligemment les responsabilités entre les différents niveaux du pouvoir politique.
À l’instar du constat posé par Gaspard Koenig sur l’amoncellement de normes aberrantes et qui l’a conduit à proposer un projet de simplification aux Français, l’ex-ministre envisage que cette coalition d’acteurs pose les fondements d’une organisation simplifiée.
Pour retrouver l’entretien dans Le Figaro, cliquer ICI.
Publié le 12/04/2022.
Interrogé en 2020 par l’hebdomadaire Marianne sur la nature du libéralisme en demi-teinte pratiqué par Emmanuel Macron, l’historien Lucien Jaume voit dans le chef de l’État le successeur du libéralisme autoritaire de Guizot.
De quel libéralisme Emmanuel Macron est-il le nom ? Pour l’historien Lucien Jaume, pas de doutes, le Président se situe dans le giron d’un autre historien, François Guizot, président du conseil des ministres durant la Monarchie de Juillet. Au XIXe siècle, deux conceptions du libéralisme s’affrontent en France. Le premier courant, celui de Madame de Staël et de Benjamin Constant, se méfie de l’État, prône la liberté de l’individu et estime que la Constitution devrait permettre au citoyen de poursuivre l’État en cas d’abus. Le second, dont Guizot sera la figure de proue, est un libéralisme impulsé par l’autorité étatique.
« Ce libéralisme élitiste et autoritaire s’est en fait assez bien accordé avec l’histoire française, celle d’un pays où l’Etat a précédé et construit la nation, où l’administration occupe un rôle central. »
Lucien Jaume juge que cette dichotomie libérale réside dans les conditions objectives d’exercice du pouvoir. Pour parer les complots qui le visaient, Guizot s’était accommodé de l’appareil d’État pour mener à bien une politique autoritaire mais économiquement libérale. Cette pratique du pouvoir a tout de même suscité de vives réactions chez les libéraux de l’époque comme le rappelle l’historien, « Guizot était traité de traître au libéralisme en 1834, lorsqu’il a quasiment interdit la liberté d’association ».
Pour Lucien Jaume, le rognement des libertés politiques au profit des libertés économiques, que l’on pourrait percevoir chez Emmanuel Macron, n’a rien d’une anomalie considérant les spécificités françaises. L’Etat ayant préexisté et façonné la nation française, l’idée d’imposer le libéralisme par sa main au gré du pouvoir exécutif et de l’administration s’est opéré de façon intuitive pour les hommes politiques et chefs d’État d’obédience libérale. Il n’est ainsi guère étonnant, pour l’historien, qu’Edouard Balladur et Valéry Giscard d’Estaing aient placé leur pratique du pouvoir sous le patronage de François Guizot.
« Tocqueville soulignait avec raison que la tradition française était très portée vers l’égalité, que la liberté était regardée comme une valeur très aristocratique. Ce n’est pas la tradition britannique : là-bas, l’Etat a une fonction utilitaire. En France, l’Etat fait vivre la nation […], quelqu’un qui promet d’aller vers plus d’égalité sera toujours plus écouté qu’un autre qui assure plus de liberté. »
L’ambivalence du libéralisme d’Emmanuel Macron – un laissez faire économique et un progressisme sociétal contrebalancés par le recul des libertés politiques – s’expliquerait par l’attachement préférentiel des Français à l’égalité plutôt qu’à la liberté. Ainsi, pour Lucien Jaume, le Président « bricole avec la tradition de l’État français ». Nonobstant, l’historien regrette l’absence d’attachement des Français à la Liberté, en témoigne les enquêtes d’opinions qui soulignent l’attente du retour d’un homme fort ou l’acceptation par la majorité d’entre eux de mesures restreignants les libertés publiques.
Pour retrouver lire l’entretien dans Marianne, cliquer ICI.
Publié le 04/04/2022.
L’ancien ministre et ex-candidat à la présidentielle Alain Madelin livre dans L’Express ses idées pour redresser la France avec un fil conducteur : la subsidiarité.
Bien que le constat d’un dysfonctionnement de l’État soit partagé par l’unanimité de la classe politique française, Alain Madelin constate l’incapacité des derniers gouvernements à mettre en place les réformes structurelles qui s’imposent à la France – avec d’autant plus d’urgence que nous sommes en retard en retard. Dans une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle, il soumet ses conseils et ses idées pour « réinventer l’État ».
« Notre État se mêle de tas de choses qui ne relèvent pas de ses fonctions, que d’autres pourraient sans doute assurer mieux que lui. Dans le même temps il exerce de plus en plus mal ses vrais métiers. »
D’après lui, cette rénovation est avant tout une chance car il y a là de quoi aller chercher un « gisement providentiel de productivité et de richesses ». Réinventer la France, c’est aussi un projet politique ambitieux, rassembleur, dont tout le monde serait bénéficiaire. Une telle transformation qui ne condamnerait pas, bien au contraire, les fonctionnaires : pour Alain Madelin, il y a dans les corps de l’État de potentiels acteurs talentueux de cette transformation. Mais il insiste sur la nécessité de restructurer les services publics – non pas pour diminuer les coûts mais de manière pragmatique pour améliorer les performances de ces services – ainsi que sur la nécessité d’introduire la concurrence lorsque cela est possible, et ce afin de permettre à chaque Français de gagner en pouvoir d’achat, en opportunité et en liberté.
« Le remède c’est la pleine dévolution de blocs de compétences au niveau régional et local et la responsabilisation par des impôts spécifiques payés par l’électeur. »
Alain Madelin voit également dans la simplification normative l’un des grands enjeux pour rénover la France qui « croule sous l’abondance des lois des décrets et des règlements ». Une idée déjà développée par GenerationLibre dans son rapport « Pour une révolution normative ! » rédigé par Jean-Ludovic Silicani, et idée phare de la campagne du candidat à la présidentielle Gaspard Koenig.
Le « fil conducteur » de ces réformes doit être, d’après Alain Madelin, la subsidiarité : laisser la société s’organiser elle-même de manière horizontale lorsque c’est possible (« subsidiarité horizontale ») ; laisser aux collectivités les plus petites le choix des compétences dont elles souhaitent s’occuper (« subsidiarité verticale »). Une approche qui rejoint le principe de subsidiarité ascendante pensé par Raul Magni-Berton pour GenerationLibre : plutôt que de laisser l’État piloter la décentralisation par le haut, nous disons que c’est aux communes, aux départements et aux régions eux-mêmes d’organiser la décentralisation. Aux collectivités de choisir elles-mêmes leurs compétences et de lever l’impôt directement pour les exercer !
Pour lire la tribune d’Alain Madelin, cliquer ICI.
Pour retrouver notre rapport « Le pouvoir aux communes », cliquer ICI.
Pour retrouver notre rapport « Pour une simplification normative ! », cliquer ICI.
Publié le 18/02/2022.
Retour sur le webinaire organisé par GenerationLibre pour présenter, avec son auteur et ami Daniel Borrillo, sa nouvelle note « Du harcèlement sexuel au harcèlement de la sexualité ». Contre l’essentialisme qui s’infiltre jusque dans le droit, Daniel appelle à réhabiliter l’universalisme pénal et à approfondir la libre disposition de soi.
La lutte contre les violences faites aux femmes est indispensable. Mais d’une lutte légitime contre les violences sexuelles ou pour l’égalité femmes-hommes, elle dérive vers une répression de la sexualité, alerte Daniel qui analyse le corpus idéologique des mouvements féministes les plus radicaux. À l’opposé du féminisme classique qui fonde sa lutte sur une quête d’émancipation organisée autour des droits fondamentaux, ce « néo-féminisme » essentialiste, que l’on retrouve dans certains des campus américains, suit une logique de répression et décrète la Femme victime et l’Homme bourreau.
Dans notre nouvelle publication, Daniel, juriste et chercheur associé au CNRS, analyse les ressorts de cette mouvance et en particulier la notion de « continuum des violences » sur laquelle elle s’appuie. D’après ce principe, toute femme est nécessairement victime et le viol n’est que l’apogée d’un système de domination qui commence dès le regard. Cette idéologie conteste donc automatiquement le droit pénal puisqu’il s’agit d’une part d’un outil au service des dominants – les hommes – et d’autre part puisqu’il ne peut condamner la violence d’un simple regard. À rebours de l’État de droit, cette contestation de la justice légitime les tribunaux populaires tenus sur les réseaux sociaux qui jugent et détruisent des vies sans autre forme de procès.
« J’étais surpris d’entendre dire que l’État et la police ne faisaient rien contre les violences sexuelles alors que je constatais tout le contraire. »
Le néo-féminisme s’insurge donc de l’inefficacité du droit – qui pourtant nous protège – et parle même de « complicité » systémique de l’État et de la police – si des abus existent et doivent être combattus, le reproche paraît outrancier. Si une intervenante souligne que l’entreprise de déconstruction de l’Homme est intéressante culturellement, ou comme le rappelle Violaine de Filippis dans sa chronique de la semaine pour l’Humanité (1), pour Daniel, il faut, en revanche, lutter contre l’introduction de cette entreprise morale dans le droit. Daniel démontre l’existence d’une surenchère normative en matière de crimes sexuels ainsi qu’une lente colonisation du droit et des discours officiels par certains concepts essentialistes comme « féminicide », « domination masculine », etc.
D’où l’inquiétude de Daniel de voir nos sociétés retomber dans une forme de puritanisme qui, d’une lutte qui doit toujours être menée contre les violences sexuelles faites aux femmes, s’attaquerait progressivement à la libre sexualité des individus et, à rebours de ce qu’il reste encore à conquérir, amoindrit la libre-disposition du corps des femmes – et des hommes – en combattant le travail du sexe, la GPA ou la pornographie.
Pour GenerationLibre, les combats à mener en droit sont clairs, à commencer par la légalisation du travail du sexe qui permettra d’autant mieux aux travailleuses – et travailleurs- du sexe de se protéger, ou encore la légalisation de la GPA, qui permettra aussi de protéger les femmes porteuses. La pénalisation des clients de la prostitution décidée en 2016, sous l’influence de ces courants féministes abolitionnistes, a au contraire aggravé les violences. Si l’on sépare droit et morale, la légalisation permet de réguler des pratiques, non pas selon des valeurs subjectives, mais pour s’assurer d’un seul principe moral : le libre consentement de chacun.e.s.
« La violence doit être sanctionnée en tant qu’attentat à l’autonomie individuelle et au consentement libre des individus, indépendamment de leur genre et de leur sexualité. »
En matière juridique, c’est aussi à la déconjugalisation du droit qu’il s’agit de s’attaquer urgemment comme l’explique récemment le candidat Gaspard Koenig à l’appui de plusieurs propositions de GenerationLibre pour individualiser notre système socio-fiscal (2). Récemment, Nicolas Gardères et Violaine de Filippis expliquaient dans Libération que la proposition phare de revenu universel portée par notre think tank, en tant que mécanisme socio-fiscal individualisé (contrairement au RSA dont le montant diminue en fonction du revenu du conjoint), était à même de réduire les écarts de revenus au sein du couple et de permettre d’échapper autant à un travail subi qu’à la puissance financière du mari – ou de l’épouse (3). C’est aussi un sujet pour le handicap : en individualisant l’AAH (Allocation aux adultes handicapés), on permettrait aux handicapés de ne pas avoir à choisir entre une vie de couple (au risque de voir l’aide diminuée) ou le renoncement à celle ci (pour conserver le montant maximal).
Ces questions autour du genre et du sexe font couler beaucoup d’encre, et électrisent aussi certains débats. Les commentaires de plusieurs participants au webinaire le confirment : entre assignation identitaire (réelle ou supposée) de genre, de sexe et de sexualité de Daniel – comment un homme pourrait parler de ce que vivent les femmes ? – et commentaires grossiers, il apparaît évident, comme le souligne une Française expatriée, que les libertés sexuelle et de parole ne vont aujourd’hui toujours pas (toujours moins ?) de soi en France.
Pour retrouver la note d’analyse écrite par Daniel Borrillo, cliquer ICI.
(1) Pour lire la chronique « Pécresse, une vraie « femme de droite » », cliquer ICI.
(2) Pour lire notre billet « RSA, AAH : déconjugaliser pour mieux émanciper », cliquer ICI.
(3) Pour lire notre billet « Le revenu universel, un outil pour les femmes contre les violences conjugales », cliquer ICI.
Publié le 16/02/2022.