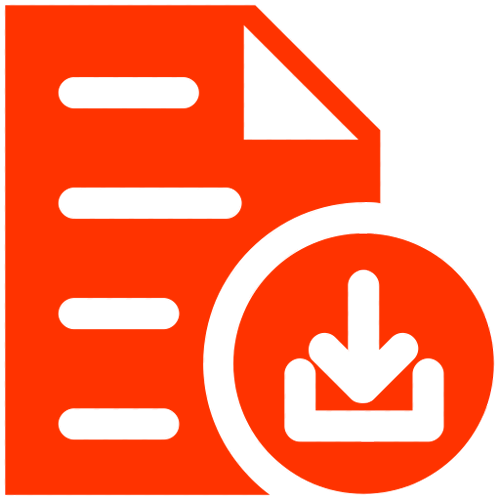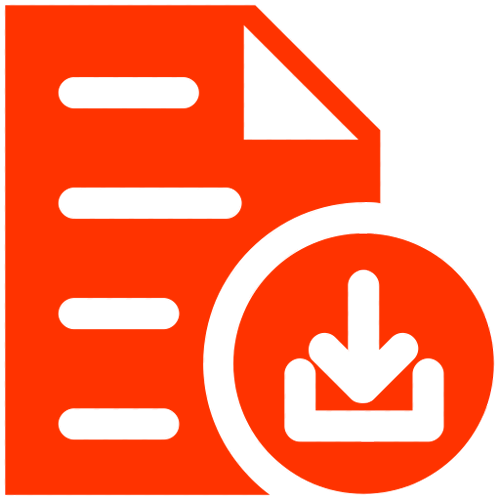
Dans son dernier livre Pour un libéralisme humaniste, notre soutien Alexis Karklins-Marchay présente une vision repensée du libéralisme, à la fois « humaniste et éthique » : l’ordolibéralisme. Revenu universel, prix carbone : il y évoque certaines de nos propositions.
Dans son introduction, Alexis fait le constat d’une crise actuelle du libéralisme : alors qu’il a été largement adopté depuis plus de deux siècles par les pays occidentaux d’abord, puis plus récemment par d’autres pays sur tous les continents, et que « jamais dans l’histoire de l’humanité l’accroissement des libertés politiques individuelles et la progression du pouvoir d’achat et de l’espérance de vie n’ont été aussi forts que ceux observés depuis la fin du XVIIIe siècle dans les nations ayant évolué vers le libéralisme », il fait l’objet de nombreuses critiques.
Qualifié de « néolibéralisme » par ses détracteurs, il fait l’objet d’accusations de la part de trois oppositions principales : l’altermondialisme et l’écologisme inspirés du marxisme qui souhaitent sortir du système libéral, les socialistes qui sont en accord avec les principes de propriété et d’accumulation de richesses du libéralisme mais qui souhaitent beaucoup plus d’État et de redistribution, et les souverainistes de Zemmour à Trump, protectionnistes d’inspiration mercantilistes qui voient dans le marché une dépossession de la souveraineté nationale.
« Après l’économie de marché, c’est une sorte « d’économie sociale, culturelle et écologique de marché » qu’il faut aujourd’hui concevoir. »
Face aux reproches faits au libéralisme (favorisation de l’individualisme, logique purement financière, consumérisme, favorisation du gigantisme, favorisation des inégalités, rapports hypocrites à l’État et responsabilité dans le réchauffement climatique), l’auteur propose non pas de sortir du libéralisme, mais de le « réinventer ». « Et si la solution n’était pas de “sortir” du libéralisme mais plutôt d’“évoluer” vers un autre libéralisme ? Un libéralisme qui reprendrait les fondamentaux dont les avantages ne sont plus à démontrer, tout en répondant aux reproches qui lui sont adressés. » Pour Alexis, ce libéralisme existe et se nomme « ordolibéralisme ».
« L’ordolibéralisme est tout simplement une philosophie à part entière, qui dépasse l’économie et qui repense la place de l’humain dans la société. »
Né dans l’Allemagne libérale des années 1920 face à la montée du national-socialisme, ce courant a été à l’origine du « miracle économique » qu’a connu le pays à partir de 1948. Pour le libéralisme du « laissez-faire » d’Hayek, l’ordre social est spontané, issu des millions d’activités économiques qui composent la société, mais n’est prévu par aucun d’entre eux. Chaque individu maîtrise sa vie au sein de la société, mais personne ne maîtrise le processus d’évolution de la société elle-même. Pour les ordolibéraux en revanche, le marché n’est pas un « phénomène naturel » mais résulte d’une organisation politique et juridique sur laquelle tous les citoyens ont prise. Ainsi pour les ordolibéraux, l’économie de marché, bien que nécessaire pour être libre, ne peut suffire à garantir la liberté et nécessite un État qui « arbitre, soigne, accompagne et incite ». Méconnu en France et délaissé dans les années 1980 au profit du libéralisme classique, il constitue pour l’auteur le moyen de répondre à la crise actuelle du libéralisme.
« Les ordolibéraux se distinguent des autres courants du libéralisme en requérant de la puissance publique qu’elle accompagne les transformations de la société inhérentes au fonctionnement de l’économie. Certes, la libre concurrence contribue à la justice sociale en cassant les rentes de situation et en laissant les marchés accessibles à de nouveaux acteurs. Mais cela n’est évidemment pas suffisant. »
Dans la première partie de l’ouvrage, Alexis dresse une histoire du libéralisme au sein de laquelle s’insère celle du courant ordolibéral. C’est notamment au moment de la crise de 1929, première vraie crise de l’histoire du libéralisme, et de la remise en cause de la politique du « laissez-faire » économique que se développe l’ordolibéralisme en Allemagne.
Face aux pensées totalitaires du national-socialisme et du communisme et à l’interventionnisme exacerbé promu par Keynes qui s’impose en Occident à partir du New Deal et jusqu’aux années 1980, le courant libéral ne disparaît pas pour autant. Il se compose alors d’une aile radicale incarnée par Hayek et Friedman notamment, et d’une aile plus modérée, « européenne », incarnée par Rustöw et Röpke notamment. Alors que c’est la ligne radicale qui sera reprise au moment du grand retour du libéralisme dans les années 1980, force est de constater que cette voie n’a pas totalement fonctionné comme en témoigne la crise actuelle du libéralisme. L’auteur préconise donc de renouer avec sa branche modérée, adoptée en Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais trop peu appliquée ailleurs.
« D’où l’utilité de redécouvrir l’odolibéralisme, ce courant qui proposait un « autre » libéralisme et qui fut progressivement éclipsé. Parce qu’il constitue la seule option aux limites actuelles de nos systèmes tout en alliant liberté économique et respect des valeurs démocratiques. Parce qu’il est un libéralisme né des critiques mêmes du libéralisme, à l’heure où celles-ci paraissent plus que jamais pertinentes. »
Après avoir détaillé son développement théorique en Allemagne et en Autriche notamment, ainsi que sa mise en place en Allemagne par le ministre de l’Économie Ludwig Erhard, ainsi que ses reprises en Italie et en France, Alexis expose les idées de l’ordolibéralisme. Il présente une pensée économique complexe, fondée sur une constitution économique, favorisant la concurrence, la liberté des prix et l’entrepreneuriat contre la bureaucratie. Pour autant, pour les ordolibéraux, l’homme n’est pas qu’un homo œconomicus entièrement mû par ses intérêts propres et la recherche de l’utilité économique.
Rejetant la « main invisible » de Smith, les ordolibéraux souhaitent la présence d’un « État arbitre » à même de casser les monopoles, favorisant la décentralisation dans tous les aspects de la vie, de la concentration démographique dans les villes à la taille des exploitations agricoles. Dans l’ensemble, Alexis nous dépeint une philosophie qui se méfie de la concentration des pouvoirs qui, selon Röpke, favorise les abus, le chauvinisme et finalement la guerre et qui repose sur une responsabilité éthique individuelle. À rebours du libéralisme classique, c’est donc une pensée qui pose l’interdépendance des sphères culturelles, politique, économique, sociale.
Reconnaissant certaines limites à la pensée ordolibérale telle que conceptualisée par Röpke, Alexis termine son ouvrage par la proposition de mesures concrètes applicables à époque actuelle, comme l’instauration d’un revenu universel, d’une taxe carbone ou la mise en place d’un Small Business Act européen. Beaucoup de propositions partagées par GenerationLibre et que nous présentions dans notre dernier ouvrage aux PUF Esquisse d’un libéralisme soutenable écrit par Claude Gamel, qu’Alexis mentionne dans son ouvrage.
« Le néolibéralisme est mort, vive l’ordolibéralisme ! »
Pour lire notre ouvrage Esquisse d’un libéralisme soutenable, écrit par Claude Gamel, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Liber : un revenu de liberté pour tous », cliquer ICI.
Publié le 04/07/2023.
Alors que la plupart des pays européens décentralisent, la France retire de l’autonomie aux territoires locaux. Dans Contrepoints, notre expert Raul Magni-Berton revient sur l’utilisation française d’un outil anachronique, au service de la centralisation : la fusion communale.
Pour Raul, la situation de l’autonomie des territoires locaux, au sein du cadre nationale, est comparable à celle des territoires nationaux réclamant leur indépendance. Il prend exemple sur la ville ukrainienne de Lviv, dont nous trouvons aujourd’hui qu’elle ait changé quatre fois d’appartenance nationale en un siècle, passant successivement d’autrichienne à polonaise, de russe à ukrainienne, au gré des conquêtes et des traités internationaux.
Aujourd’hui, « nous estimons que les territoires et leurs habitants ne sont pas des choses à échanger ou à conquérir. Ils ont des droits, et notamment celui d’avoir leur mot à dire sur leur place au sein d’un système et d’une culture nationale […]. Pour autant, ce bon sens peine à s’appliquer au niveau infranational, particulièrement en France. »
« [Les territoires] n’ont pas le droit de sauvegarder leurs frontières, de lever l’impôt, d’exercer les compétences qu’ils estiment utiles à leur développement, de choisir leurs propres règles de décision parce que, comme chacun le sait, en France, c’est l’État et seulement l’État qui dispose de telles compétences. »
Ainsi, au sein du cadre national, c’est à l’État de décider pour les échelons locaux, comme en témoignent la réforme des régions redessinées par le pouvoir central ou les intercommunalités qui ont été souvent des « mariages forcés entre communes réticentes ». Et même si elles sont impopulaires, ces pratiques restent tolérées en France. Les régions « n’ont pas le droit de sauvegarder leurs frontières, de lever l’impôt, d’exercer les compétences qu’ils estiment utiles à leur développement, de choisir leurs propres règles de décision parce que, comme chacun le sait, en France, c’est l’État et seulement l’État qui dispose de telles compétences ».
« En Europe, les pays tendent à se décentraliser, et l’Union européenne elle-même prône le principe de subsidiarité qui permet aux territoires d’avoir davantage de droits, en prenant des décisions dans les domaines où il est plus efficace que ce soit eux qui les prennent. »
Pourtant, aux yeux de Roul, « la centralisation française est de plus en plus anachronique » à l’heure où la plupart des pays européens tendent à se décentraliser et où l’Union européenne elle-même souhaite accorder davantage de pouvoir aux territoires, guidée par le principe dit de « subsidiarité », qui considère qu’une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l’échelon inférieur.
Alors que les études montrent qu’un tel principe permet une plus grande efficacité et transparence et à l’heure où les citoyens et élus locaux demandent davantage d’autonomie, la France a certes mis en place des lois de décentralisation, mais qui « produisent paradoxalement de moins en moins d’autonomie des territoires ».
« Les études scientifiques soulignent (…) que dans les pays développés, l’autonomie des territoires est source d’efficience et de transparence. Elle a même des vertus en situation d’urgence, comme nous avons pu le voir pendant la pandémie de la covid. Enfin, les citoyens et les élus locaux – qui sont les représentants les plus populaires de France – ne cessent de demander plus d’autonomie. »
Il en va ainsi par exemple des lois de 2010, 2015 et 2019 sur les collectivités territoriales qui permettaient aux communes de fusionner librement et sans contrainte en créant une commune nouvelle. En effet, cette « liberté » apparente de fusionner s’est accompagnée de coupes budgétaires, rendant les communes davantage dépendantes aux subventions de l’État, qui ne s’appliquaient pas aux communes acceptant de fusionner. Par ailleurs, le préfet avait également la possibilité d’imposer la fusion entre plusieurs communes, mais sans les bénéfices liés à un fusionnement volontaire. « Dans ces conditions, les fusions consensuelles ressemblent plutôt à des mariages forcés », résume Raul.
Face à cette situation, il préconise des fusions choisies, fondées sur le principe de subsidiarité ascendante et motivées par des raisons aussi bien économiques (« les communes qui n’arriveront pas à se gérer efficacement seront tentées de s’annexer à celles qui, au contraire, auront fait les bons choix ») que culturelles.
Pour lire l’article de Raul, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Le pouvoir aux communes », cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Fiscalité locale : Oser “Pacte girondin” », cliquer ICI.
Publié le 03/07/2023.
Pour Contrepoints, notre expert et juriste Daniel Borrillo revient sur la situation des travailleuses et travailleurs du sexe en France et propose la solution qu’il a soutenue dans notre dernier rapport : « Faire entrer le travail du sexe dans le droit commun ».
Daniel Borrillo expose dans une tribune, un an après la légalisation du travail du sexe en Belgique, nos arguments en faveur d’une dépénalisation de la prostitution. Co-écrit avec Cybèle Lespérance et Édouard Hesse, notre rapport « Faire entrer le travail du sexe dans le droit commun » a fait l’objet de nombreuses reprises depuis sa publication au début du mois de juin dernier par Le Point, Marianne, Libération ou encore Madmoizelle, et a recueilli le soutien public d’Anne Souryis, adjointe à la mairie de Paris, ainsi que de Sergio Coronado, ancien député EELV, et a fait réagir l’ancienne ministre Laurence Rossignol.
À l’opposé de la Belgique, premier pays européen à reconnaître la prostitution comme une activité professionnelle avec les mêmes droits et obligations que n’importe quel travail, la France sanctionne les acheteurs d’actes sexuels depuis la Loi de « pénalisation des clients » de 2016, « faisant de tous les clients des délinquants, et de l’ensemble des prostitués des victimes ».
« Désormais, la prostitution devrait être considérée comme un métier dont la pratique résulte d’un choix et d’une quête d’autonomie et de contrôle sur son propre corps ».
Pourtant, Daniel s’appuie sur le travail de trois études sur le sujet pour montrer que les conditions des travailleuses et travailleurs du sexe se sont dégradées depuis l’instauration de la loi : le Ministère chargé de l’Égalité entre les Hommes et les Femmes dans un rapport de décembre 2019, comme Médecins du monde et les sociologues N. Gaudy et H. Le Bail (CNRS – Sciences Po) parviennent au même aux mêmes conclusions. La pénalisation des clients a en effet notamment entrainé une raréfaction des clients qui réduit la liberté des travailleuses et travailleurs du sexe à pouvoir refuser certains clients et certaines pratiques comme les rapports sans préservatif, ainsi qu’un isolement des TDS.
« Comme tout travail, la prostitution peut être libre ou subie, le seul moyen efficace de mettre fin à l’exploitation est de rendre les prostitués, hommes et femmes, libres de leur force de travail, soumettant ainsi cette activité aux mêmes règles de droit auxquelles est assujetti tout acteur économique. »
Face à cette situation, Daniel propose dans notre dernier rapport, fondé sur l’analyse comparative de différents pays, d’établir une distinction claire entre exploitation sexuelle et travail du sexe, afin de mieux combattre la première et d’améliorer les conditions de la seconde. En reconnaissant la prostitution comme « un métier dont la pratique résulte d’un choix », l’entrée du travail du sexe dans le droit commun et la création de contrats de travail permettrait d’offrir une vraie protection juridique aux travailleuses et travailleurs.
Des contrats aux formes multiples (CDI, CDD, « chèque emploi-service sexuel ») qui prendraient évidemment en compte la spécificité du travail sexuel, en incluant des clauses spécifiques (rétractation, non-discrimination, interdiction d’exonération rémunérative, nullité des clauses abusives du droit du travail…) afin de garantir l’intégrité des travailleurs. « Le seul moyen de mettre fin à l’exploitation et aux discriminations liées à la prostitution, c’est de la considérer comme un métier. »
« Dès lors qu’on écoute les travailleuses et travailleurs du sexe, on s’aperçoit que la plupart des problèmes qu’ils rencontrent sont étroitement liés à l’absence de statut professionnel ».
Pour lire notre dernier rapport « Faire entrer le travail du sexe dans le droit commun », cliquer ICI.
Pour lire la tribune de Daniel, cliquer ICI.
Pour lire l’article de Libération, cliquer ICI.
Pour lire l’article du Point, cliquer ICI.
Pour lire l’article de Marianne, cliquer ICI.
Pour lire l’article de Madmoizelle, cliquer ICI.
Publié le 29/06/2023.
Dans l’Opinion, notre présidente Monique Canto-Sperber soutient que la Maison du dessin de presse ne doit pas voir le jour si elle n’expose pas les 12 caricatures de Mahomet. Si elle ne doit pas être héroïsée, la liberté de blasphémer ne doit souffrir aucune exception pour autant.
Monique loue la volonté de saluer la tradition ancienne du dessin caricatural, fruit d’un « esprit français, mordant et parfois méchant » en matière d’humour, surtout aujourd’hui « où l’on tend à invoquer l’offense que peuvent causer des expressions transgressives pour mieux les censurer. »
Forme « d’expression artistique […] délibérément biaisée, exagérée, déformée », la caricature « n’affirme et ne démontre rien ». Son outrance n’a pas pour objectif d’argumenter en faveur d’une thèse mais de faire rire et susciter une réaction, ce qui fait qu’elle bénéficie d’une forme particulière d’impunité.
« Les caricatures n’affirment et ne démontrent rien. Elles ne sont ni un ensemble de thèses, ni une revendication. Elles recourent souvent à des stéréotypes et, pour faire rire et toucher juste, doivent être sans justice. »
La caricature est ainsi par nature « déplaisante et choquante ». Et même si personne ne souhaite voir l’objet de ses croyances moqué, ce processus fait partie même de la caricature. Et comme le rappelle Monique, la Révolution française a aboli le délit de blasphème et par là-même celui d’insulte à la religion. En revanche, insulter un individu en raison de sa croyance constitue une circonstance aggravante.
« L’insulte à la religion est à l’abri de toute poursuite pénale, le délit de blasphème ayant été aboli depuis la Déclaration des droits de l’homme. »
Monique comprend les inquiétudes des responsables du musée, qui redoutent que l’exposition des caricatures ne participe à l’accroissement des tensions. Mais pour elle, « la liberté de blasphémer est non contextuelle, soit elle est, soit elle n’est pas ». Ainsi la création d’une clause de protection à l’égard des musulmans en particulier serait antinomique avec un droit de blasphémer.
Monique conclut : « si la Maison du dessin de presse devait renoncer à montrer ces images [les caricatures de Mahomet], cela reviendrait à ouvrir un musée dont l’objet principal serait absent, à savoir la caricature religieuse moqueuse, choquante, mais permise, quelles que soient les réactions du public. Dans ce cas, il vaudrait mieux renoncer à ouvrir un tel musée. »
Pour lire la chronique de Monique, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Pour rétablir la liberté d’expression », cliquer ICI.
Publié le 28/06/2023.
Dans un article publié dans Sociétal, la revue de l’Institut de l’Entreprise, notre expert Marc de Basquiat dénonce un système français des minima sociaux trop complexe et désincitatif au retour à l’emploi. Il plaide pour l’instauration d’un impôt négatif : le revenu universel.
Marc souhaite avant tout garantir un revenu de subsistance à chaque citoyen français. Actuellement, dix minima sociaux permettent à 4,5 millions de bénéficiaires, et 2,6 millions de personnes à charge, de vivre. Il revient sur l’histoire de l’impôt négatif en France et dans le monde et par ailleurs sur la proposition de Benoît Hamon lors la présidentielle de 2017 de mettre en place un revenu universel ou encore sur la création du Revenu universel d’activité par Emmanuel Macron, projet qui visait à fusionner le RSA, la prime d’activité et les aides au logement.
« Un ensemble assurant tant mal que bien la survie de presque 10 % de la population de notre pays mérite plus de courage politique que l’emploi d’un terme caricatural : l’assistanat. »
Marc l’affirme : notre système socio-fiscal actuel désincite au travail. Il revient sur les multiples allocations existantes allouées aux individus les plus fragiles (ADA, RSO, AAH, ASPA, ASS…), lorsque ces derniers n’arrivent pas se suffire des gains provenant de leur activité professionnelle. Dans certains cas, en travaillant davantage, les allocataires n’ont aucun gain supplémentaire. Marc se penche particulièrement sur les modalités d’octroi du RSA (dernière prestation dans la hiérarchie sociale française) qui est calculé sur la base du montant maximum théorique auquel on soustrait toutes les ressources financières obtenues par l’allocataire. Le système, bien trop complexe, induit de nombreuses erreurs. Pour un bénéficiaire du RSA, il apparaît clairement que le retour à l’emploi n’est pas la solution la plus pertinente, au vu de la perte financière engendrée et des avantages complémentaires diminués.
« Cette soustraction des revenus d’activité est le propre de toutes les allocations « différentielles » qui garantissent un certain niveau de ressource total en supprimant toute motivation financière à une activité modeste. »
Pour Marc, cet effet négatif des minima sociaux sur l’offre de travail n’est pas nouveau. Il s’agit d’une problématique connue depuis la fin du XVIIIe siècle et soulevée notamment par Malthus ou Marx. Marc dénonce les effet revenu et de substitution qui interfèrent sur le point d’équilibre entre offre et demande et biaisent le marché du travail. Lorsqu’un individu estime percevoir des revenus suffisants pour vivre, il ne retournera à l’emploi que pour des fins autres qu’économiques : il s’agit là de l’effet revenu. L’effet de substitution, lui, concerne les individus qui travaillent peu et qui décident de travailler plus, si et seulement si le gain additionnel est assez significatif.
La critique actuelle des minima sociaux se focalise principalement sur leurs montants. Certains estiment que la combinaison de toutes les aides sociales octroyées à un allocataire se rapproche du montant du SMIC et donc que le différentiel de revenus entre un allocataire et un travailleur est trop faible. Cependant, la majorité des minima sociaux sont des prestations différentielles qui interviennent sur les revenus du ménage entier, pas seulement de l’allocataire. Ainsi, Marc souhaite aller plus loin et agir sur « le taux marginal de prélèvement implicite », qui décourage l’inclusion par le travail des allocataires.
« Lorsqu’il s’agit d’encourager les bénéficiaires de l’aide sociale à chercher un travail, on est face à deux options : baisser le niveau de l’aide pour agir sur l’effet revenu (motiver par la faim) ; ne soustraire qu’une partie des revenus d’activité (motiver par le gain). »
Pour mettre fin à cette complexité et ces désincitations, notre expert propose une solution efficace, bien que radicale : la revenu universel, dont il est l’un des fervents défenseurs. La notion d’impôt négatif a vu le jour dès 1838 en France, sous la plume de Cournot qui a imaginé que le calcul des impôts pourrait aboutir à un reversement de l’État aux contribuables. Cette proposition s’est exportée ensuite en Angleterre et aux États-Unis et a été reprise par de nombreux économistes. Ces débats ont, par exemple, donné lieu au « earned income tax credit » (EITC en 1975 aux États-Unis) ou d’autres expérimentations. Les conclusions finales en sont plus que positives et ont démontré l’impact de cette solution fiscale sur le taux marginal de prélèvement implicite.
En 1974, l’économiste et secrétaire d’État Stoléru ramène cette idée dans le débat mais cela n’a, in fine, abouti qu’à l’augmentation par Valéry Giscard d’Estaing du minimum vieillesse, par crainte d’être accusé d’inciter à la fainéantise. Par la suite, François Mitterrand s’inspire de Stoléru et met en place le « revenu minimum d’insertion » (RMI), malheureusement encore une prestation différentielle avec un taux de prélèvement marginal de 100%. Le nombre de bénéficiaires du RMI en hausse constante, Lionel Jospin instaure la première version d’impôt négatif en France (PPE : Prime pour l’emploi) mais sans effet incitatif et trop complexe.
« Serait-il possible de concevoir un dispositif plus satisfaisant, protégeant efficacement les personnes sans les décourager de travailler ? »
Marc souligne l’avancée majeure que représente le prélèvement à la source mis en place en 2018. « Le fisc est donc capable de calculer chaque mois un impôt négatif en fonction des revenus du mois écoulé ». De plus, l’impôt sur le revenu a fortement augmenté ces dernières années (pourtant acquitté par seulement 44% des ménages).
Concrètement, Marc appelle à transformer le calcul mensuel de l’impôt sur le revenu actuel en un impôt négatif, un revenu universel inconditionnel et généralisé. Cet impôt négatif serait ajouté dans le calcul de la base ressources. Ainsi, les prestations sociales seraient finalement nulles si leur montant actuel est inférieur à l’impôt négatif. Les dispositifs actuels obsolètes disparaîtraient au fur et à mesure, le taux de prélèvement marginal sur les revenus d’activité, à hauteur de 30% serait plus raisonnable. La mise en place de ce nouveau et ambitieux dispositif socio-fiscal ne pose, selon Marc, aucune difficulté technique, au contraire elle assurerait « la robustesse d’un socle de revenu pour tous ». La seule opposition apparaît sur le plan politique et philosophique, qu’il est urgent de dépasser.
« C’est plutôt l’agilité de nos esprits habitués à ranger les personnes dans diverses catégories concernées par autant d’outils de plus en plus compliqués qui est en jeu. Peut-être que la question la plus fondamentale est celle-ci : à qui profite la complexité croissante de nos systèmes socio-fiscaux ? »
Pour lire l’article de Marc, cliquer ICI.
Pour consulter notre rapport « Liber : un revenu de liberté pour tous », cliquer ICI.
Publié le 27/06/2023.
Notre expert Raul Magni-Berton, dans Le Monde, et notre directeur Christophe Seltzer, dans Atlantico, voient dans la polarisation de la société française et l’hyperprésidentialisme du voyage du Président à Marseille deux symptômes du déséquilibre des institutions.
D’après le baromètre imaginé en 2019 par des chercheurs de l’université Charles-III de Madrid, la France figure en première place des pays européens les plus polarisés. Fondé sur l’analyse des pages et des profils Facebook de 234 partis européens, cet indicateur utilise un indice de polarisation politique créé en 2008 par l’universitaire américain Russell J. Dalton. Sur une échelle de 0 à 10, alors que l’Irlande, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Suède ou les Pays-Bas ont un score inférieur à 5, la France obtient le score le plus élevé avec 5,83. Ce concept de polarisation mesure à la fois la concentration des opinions au sein d’un groupe, et en même temps l’écart des opinions d’un groupe avec ceux d’autres groupes. En clair, il mesure à quel point les membres d’un groupe sont d’accord entre eux et en désaccord avec les autres groupes.
Comme le rappelle l’auteur de l’article, la polarisation n’est pas forcément une mauvaise chose : la démocratie repose précisément sur la libre expression de la multiplicité des opinions et des points-de-vue. En ce sens, une société démocratique est par essence polarisée. Pourtant, au-delà d’un certain degré, cette polarisation est le signe de la difficulté à trouver des consensus satisfaisants pour l’ensemble des citoyens, et du peu de personne qu’ils contentent.
Les chercheurs parlent également de « polarisation affective » lorsque les tensions infusent l’ensemble de la société et jusqu’à créer des divisions entre les citoyens. Ce type de polarisation porte alors davantage sur les enjeux culturels clivants comme le genre ou la race que sur des débats techniques concernant les politiques économiques par exemple, dont les enjeux sont moins facilement perceptibles : « le différend politique fait alors place à l’antipathie, au ressentiment, voire à la haine ». La polarisation affective représente dès lors souvent « un danger pour la démocratie » en donnant lieu à des débats davantage émotionnels que rationnels.
« Cette primauté de l’exécutif peut donner le sentiment que le pays est gouverné. Mais l’ambition d’une démocratie libérale, ce n’est pas de faire aboutir coûte que coûte les projets de la majorité : c’est de conférer de la légitimité à ses décisions. » – Raul Magni-Berton
Si la polarisation de la société américaine ne fait pas de doute, tant la modération s’est raréfiée au sein du camp démocrate comme républicain, la situation en l’Europe semble moins claire. En France notamment, la séquence des retraites interroge et les avis d’experts divergent pour savoir si oui ou non elle a révélé une polarisation particulière au pays. Pour notre expert Raul Magni-Berton par exemple, « les stratégies partisanes fondées sur la distinction “amis-ennemis” s’intensifient » au sein de l’hexagone, là où pour Tristan Guerra et Olivier Rozenberg, le PS et les LR témoignent de la persistance d’une volonté de compromis encore bien présente sur l’échiquier politique français.
« En instituant un exécutif puissant et en renforçant, par le biais du mode de scrutin, le parti dominant, les institutions de la Ve République ajoutent de la polarisation à un monde politique déjà polarisé. » – Raul Magni-Berton
Au-delà de ces divergences d’analyse, tous s’accordent en revanche sur les transformations du paysage politique français qu’a induit la Ve République (1958). Si jusqu’aux années 1990 la bipolarisation entre gauche et droite est très marquée et dépasse même le champ strictement politique pour devenir structurant pour l’ensemble de la société, l’heure est désormais à la « tripolarisation ». « Trois partis peuvent actuellement accéder au second tour de la présidentielle ou des législatives, mais aucun n’obtient la majorité absolue, tous rechignent aux alliances et l’un d’entre eux, le Rassemblement national, est exclu du jeu politique », souligne Raul.
Pour lui, la responsabilité vient également de la forme des institutions de la Ve République qui reposent sur un exécutif fort et qui ainsi « ajoutent de la polarisation à un monde politique déjà polarisé. Au lieu de bâtir du consensus, ce système majoritaire nourrit les tensions et les affrontements. Ces dissensions n’empêchent certes pas le gouvernement de gouverner, comme l’a montré l’épisode des retraites, mais elles fragilisent la cohésion sociale et engendrent une grande défiance envers le parti au pouvoir et les institutions. »
« Les sociétés européennes sont de plus en plus pluralistes et les paysages politiques de plus en plus fragmentés mais, au lieu de renforcer l’exécutif et de fabriquer au forceps des majorités artificielles, il vaudrait mieux que la France apprenne à “faire avec” la polarisation – c’est-à-dire qu’elle adopte un mode de gouvernement qui apaise les tensions, qui suscite l’adhésion et qui encourage le compromis. » – Raul Magni-Berton
Cela se traduit notamment pour l’auteur par un taux record de défiance vis-à-vis des formations politiques : 45% des Français déclarent n’avoir confiance en aucune formation, là où ce chiffre tourne autour des 20% au Danemark, en Suisse, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne et tombe à 10% en Norvège et Suède.
Selon Raul, face à une polarisation croissante, au lieu de renforcer un exécutif qui ne fait que maquiller l’absence de consensus clair et ne satisfait qu’une minorité, les sociétés européennes devraient davantage apprendre à faire avec cette polarisation en changeant le mode de scrutin pour un scrutin proportionnel par exemple, tel que mis en place en Allemagne ou dans les pays scandinaves notamment.
Pour lire l’article du Monde avec Raul, cliquer ICI.
Pour lire l’article de Christophe dans Atlantico, cliquer ICI.
Pour lire notre recueil « Déprésidentialiser la Ve République », cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Décentraliser par la subsidiarité ascendante », cliquer ICI.
Publié le 26/06/2023.
Dans un entretien croisé pour Atlantico, notre expert Marc de Basquiat démontre que les riches ne paient pas moins d’impôts que le reste des Français et appelle à plus de courage politique pour mener une réforme de la fiscalité.
Pour Marc, contrairement à ce qu’affirme une récente étude de l’Institut des Politiques Publiques et au sentiment des Français, les riches ne paient pas moins d’impôts que les autres citoyens. Notre expert explique que le calcul de cette étude confond le patrimoine personnel et professionnel. Il utilise l’exemple d’un dirigeant d’entreprise : pour commencer, l’entreprise s’acquitte de l’impôt sur les sociétés (IS) à hauteur de 25% sur les bénéfices. Le dirigeant doit alors se verser un dividende s’il veut utiliser les fonds restants à titre personnel. Ce dividende est soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Finalement, Marc démontre que « le prélèvement sur le « bénéfice distribué » de l’entreprise est de 47,5 % pour que l’actionnaire puisse utiliser cet argent à titre personnel, et non les 26 % indiqués par l’IPP ».
Marc salue deux réformes menées depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir : le prélèvement forfaitaire à 30% sur les revenus financiers et la baisse du taux d’impôt sur les sociétés à 25%, qui nous ont permis de retrouver de la compétitivité en Europe.
« L’attractivité économique de la France a un prix, qu’il faut comprendre comme un investissement rentable : la recette totale de l’impôt a évolué positivement ces dernières années, ainsi que les chiffres du chômage. »
Marc s’inquiète de la capacité des grandes entreprises et des grandes fortunes à déplacer leurs activités et investir ailleurs, notamment dans d’autres pays européens fiscalement plus attractifs. Pour lui, l’harmonisation des pays européens sur les taux d’imposition est légitime et utile pour le maintien de la compétitivité. Il préconise de revoir à la baisse le taux de prélèvement sur les particuliers mais juge le taux de 30% sur les revenus financiers peut-être trop bas.
« Aujourd’hui, rien n’a changé : nous sommes toujours englués dans des discours emplis de « bons sentiments » et de propagande gauchiste destructeurs pour l’économie du pays. »
Marc appelle à simplifier l’imposition afin que chaque citoyen la comprenne (comme inscrit dans la Constitution). Pour ce faire, la mise en place d’une « flat tax » apparaît comme le moyen le plus pertinent et simple. Chaque citoyen se verrait imposé à hauteur de 30% sur chaque revenu.
Quant à une éventuelle sortie de l’Europe comme solution, notre expert y est radicalement opposé. Pour lui, ce n’est pas l’Europe qui nous empêche de prendre des décisions mais simplement le manque de « rigueur intellectuelle, de cohérence et de courage politique ». Nous disposons d’assez de marges de manoeuvre pour mener à bien les réformes fiscales nécessaires pour obtenir plus d’efficacité et d’équité.
« Il est essentiel pour la démocratie que les taux et les règles de calcul de l’impôt soient simples et transparents. C’est une condition indispensable pour prétendre réaliser une justice fiscale. »
Pour lire l’entretien de Marc, cliquer ICI.
Pour comprendre notre proposition de réforme socio-fiscale, cliquer ICI.
Publié le 22/06/2023.
Dans sa chronique pour L’Opinion, notre ancien directeur Maxime Sbaihi s’oppose au wokisme comme à l’antiwokisme et dénonce une logique mortifère où la radicalité répond à la radicalité, empêchant la nuance et le débat d’idées.
Pour Maxime, le wokisme est une idéologie qu’il faut combattre. Ce « totalitarisme déguisé en progressisme » dont la « pierre angulaire est l’intolérance » s’attaque directement à la liberté d’expression et s’oppose au débat d’idées.
Cependant, pour le chroniqueur, le mouvement fait l’objet d’une attention disproportionnée là où les sondages montrent que la plupart des Français ne s’intéressent pas au sujet, tant son « fond biologisant et déterministe est en contradiction avec les valeurs des Lumières et de notre universalisme républicain » français. Et même aux États-Unis, le mouvement semble faiblir.
« Tous ces anti-wokistes autoproclamés finissent par adopter les mêmes méthodes et attitudes qu’ils prétendent combattre. […] Le piège du wokisme est de convertir, à l’usure, certains de ses détracteurs aux réflexes de l’illibéralisme et de l’intolérance. »
Face au mouvement, une opposition s’est constituée autour de l’antiwokisme. Pourtant, loin de promouvoir le dialogue et l’ouverture d’esprit, cette opposition se cristallise autour de figures qui souhaitent interdire la pensée woke pour la combattre, soit appliquer les mêmes méthodes que celles qu’ils disent combattre.
Dans les rangs trumpistes jusqu’à Ron DeSantis, aux États-Unis, au nom de l’antiwokisme on interdit des livres et restreint la liberté d’expression. Inquiétant, en France, Marine le Pen semble avoir pris la décision de mener ce combat en France. Le débat public se retrouve ainsi parasité par une confrontation entre deux extrêmes qui ne supportent plus la nuance et la modération. Face au wokisme, il faut donc résister au piège de la radicalité inverse sans abandonner le terrain de la bataille des idées.
Pour lire la chronique de Maxime, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Pour rétablir la liberté d’expression », cliquer ICI.
Publié le 21/06/2023.
Dans une nouvelle vidéo, Liber-thé s’entretient avec notre expert et professeur émérite d’économie Claude Gamel auteur de l’ouvrage Esquisse d’un libéralisme soutenable dans la collection de GenerationLibre aux PUF.
D’abord interrogé sur les raisons de défendre le libéralisme aujourd’hui, Claude revient sur les causes du discrédit, notamment français, de cette philosophie politique. L’économiste cite d’abord une raison historique qu’est la construction politique française « autour d’un État central puissant » laissant d’emblée peu de place aux communautés politiques de base. Par ailleurs l’économie, et notamment l’économie de marché, est mal comprise en France selon lui, que ce soit la coordination des activités économiques ou les mécanismes de création de richesse.
De plus, Claude trouve « le débat sur le libéralisme très mal posé » en France en raison d’une distinction qui n’a pas lieu d’être entre d’un côté le libéralisme politique, implicitement bien vu car protégeant l’individu de l’État, et de l’autre le libéralisme économique qui aliénerait l’individu aux « foucades du marché ».
À l’origine de ce malentendu se trouve le mot « néo-libéralisme » qui est source d’une grande confusion pour l’économiste, tant il est employé dans un sens flou dans le débat courant, notamment sous l’influence de la pensée de Bourdieu et du marxisme contemporain.
Selon lui, le libéralisme tend à être confondu avec le néo-capitalisme caractérisé notamment par la concentration extrême des richesses. Mais ce faisant, ce qui est critiqué est davantage la manière dont est appliqué le capitalisme que le modèle libéral en soi, qui ne se réduit pas à une mise en pratique à un moment donné. Face à cette dichotomie, Claude s’attèle à théoriser une vision du libéralisme entendu en son sens politique et économique, défini comme « la philosophie qui permet la diffusion maximale du pouvoir, qu’il soit politique ou économique ».
« Le débat sur le libéralisme est très mal posé : on fait une distinction complètement étanche entre libéralisme politique d’un côté et libéralisme économique de l’autre »
Claude revient ensuite sur la distinction essentielle entre utilitarisme et libéralisme, qui sont souvent confondus. « L’utilitarisme est la philosophie sous-jacente de la théorie économique ». Si à l’échelle individuelle les deux philosophies ont tendance à beaucoup se ressembler, elles présentent des différences majeures à l’échelle collective. Là où le libéralisme vise à ce que chacun puisse faire ce qu’il veut sans gêner autrui, sans qu’il y ait d’autre projet pour la société, l’utilitarisme assigne un but à la société, celui d’atteindre le bonheur du plus grand monde, soit la meilleure efficacité économique, même si pour cela certaines libertés individuelles doivent être contraintes.
À ce titre, l’utilitarisme politique nécessite beaucoup de données et de calculs ainsi qu’une grande planification pour viser une efficacité maximum au sein de la société. « Il passe donc nécessairement par une intervention » de l’État.
Pour Claude, l’utilitarisme recherche le « bonheur du plus grand nombre » (quitte à ce que ce bonheur du plus grand nombre ne soit pas en accord avec les bonheurs individuels) là où le libéralisme vise à permettre « le plus grand bonheur de chacun ».
Pour l’économiste, la collecte toujours plus importante de données et la puissance de calcul toujours accrues que permet l’ère du numérique actuelle rend possible l’existence d’une société pleinement utilitariste, comme le montre l’exemple de la Chine qui glisse vers un « utilitarisme totalitaire » selon ses mots.
« La technologie « donne une puissance beaucoup plus forte à l’autorité publique […] : l’exemple qui m’inquiète beaucoup c’est le cas de la Chine où on est allé très loin dans la numérisation de la société, où les gens sont surveillés au sens le plus précis du terme et où on est arrivé à récompenser les bons comportements et à punir les mauvais. […] L’objectif n’est pas de punir les gens mais d’assurer la cohésion de la société. »
Pour atteindre son objectif d’un « capitalisme soutenable », Claude défend, en s’appuyant notamment sur le principe de Rawls d’« égale liberté » et sur les travaux de Philippe Van Parijs, l’instauration d’un revenu de base universel, distribué sous la forme d’un crédit d’impôt. Il permettrait selon lui de ne pas être contraint d’accepter des emplois de mauvaise qualités et permettrait de « donner du pouvoir à ceux qui n’en ont pas ». Partant de résultats d’études menées sur la question, Claude nous assure être convaincu que, loin d’inciter les gens à ne plus travailler du tout, il conduira au contraire les gens à choisir une activité épanouissante pour eux, tout en pouvant prendre davantage de temps pour choisir leur métier.
« Le libéralisme est la philosophie qui permet la diffusion maximale du pouvoir, qu’il soit politique ou économique. »
Claude s’attache également à bâtir un modèle qui permettrait d’augmenter les « capacités » des individus. Il s’appuie là aussi sur le principe rawlsien de « juste égalité des chances » qui vise à contrer l’arbitraire des conditions sociales et sur les travaux d’Amartya Sen sur les « capabilités » (capabilities) soit l’ensemble des modes de vie auxquels a accès un individu. Pour Claude, enrichir les capacités d’un individu, c’est donc permettre à tous les individus à tous les âges de la vie d’avoir le plus de choix concernant leur mode de vie, ce qui passe avant tout pour lui par une réforme du système éducatif moins centralisé et fondé sur l’initiative locale, et un système universitaire sélectif et à dominante privée.
Le conseil de lecture de Claude : Droit, législation et liberté de Friedrich Hayek.
Pour voir l’entretien, cliquer ICI.
Pour découvrir le livre de Claude Gamel Pour un Libéralisme soutenable, cliquer ICI.
Publié le 20/06/2023.
Dans la Revue politique et parlementaire, notre expert et juriste Daniel Borrillo s’inquiète du projet de loi visant à durcir la législation sur la pornographie. En réaction à l’entretien de Laurence Rossignol, il défend un droit fondamental au nom de la liberté sexuelle.
Dans une tribune, Daniel commence par dénoncer l’amalgame que réalise selon lui le rapport de la Délégation sénatoriale aux droits des femmes, Porno, l’enfer du décor, et qui ne distingue pas entre consommation par les mineurs, que notre expert veut évidemment interdire, et consommation par des adultes responsables, qui relève d’un choix individuel. Il défend à ce titre le droit au visionnage de contenus pornographiques qui tombe sous la définition de la liberté de la DDHC de 1789, soit une activité « qui ne nuit pas à autrui », et à la production qui relève selon le droit européen de la liberté d’expression.
« Concernant l’accès à la pornographie, d’emblée nous constatons dans la législation une contradiction entre les différentes majorités. Elle est fixée à 15 ans pour la pratique sexuelle et à 18 ans pour visionner un film pornographique. Notre société n’autorise pas à voir des choses qu’elle permet cependant de faire. »
Sans évidemment cautionner certaines pratiques de la pornographie, et reconnaissant volontiers les terribles abus auquel son manque d’encadrement conduit, Daniel relève pourtant la difficulté à analyser un phénomène social par ses dérives. Condamnables, ces abus sont par définition anormaux et ne sauraient constituer la matière première de l’étude juridique de la pornographie. Pour le juriste, c’est au contraire par l’entrée de la pornographie dans le droit commun que l’on peut limiter l’exposition des acteurs de l’industrie aux violences, en régularisant les contrats de travail par exemple.
« Il ne s’agit pas seulement d’éviter la censure (liberté négative) mais de garantir aussi l’accès à la pornographie comme une forme de bien-être érotique (liberté positive) qui participe à l’autoréalisation personnelle. »
Daniel rappelle enfin qu’il revient à chacun de pouvoir développer sa propre vision de la sexualité et que la non-interdiction de la pornographie n’est en aucun cas équivalente à une obligation de la visionner. Forme de « bien-être érotique », elle relève pour l’auteur d’un droit fondamental, au principe de la liberté sexuelle.
Pour lire la tribune, cliquer ICI.
Pour lire notre rapport « Faire entrer le travail du sexe dans le droit commun », cliquer ICI.
Publié le 19/06/2023.