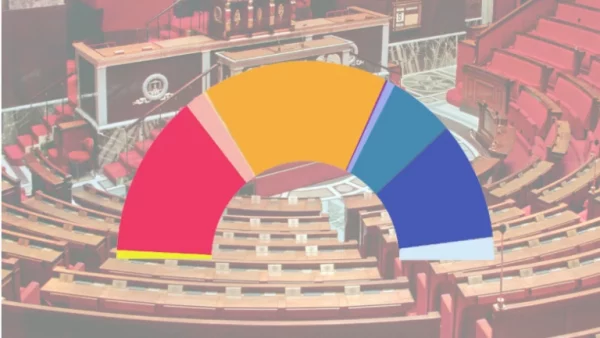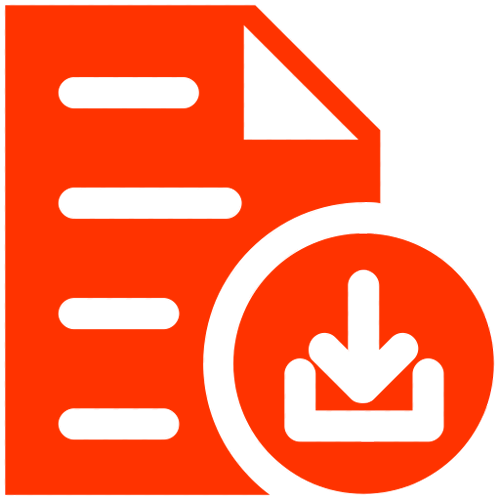Les désillusions du progrès, trésor méconnu d’Aron

Essayiste, il est notamment l'auteur de Pour un libéralisme humaniste (2023).
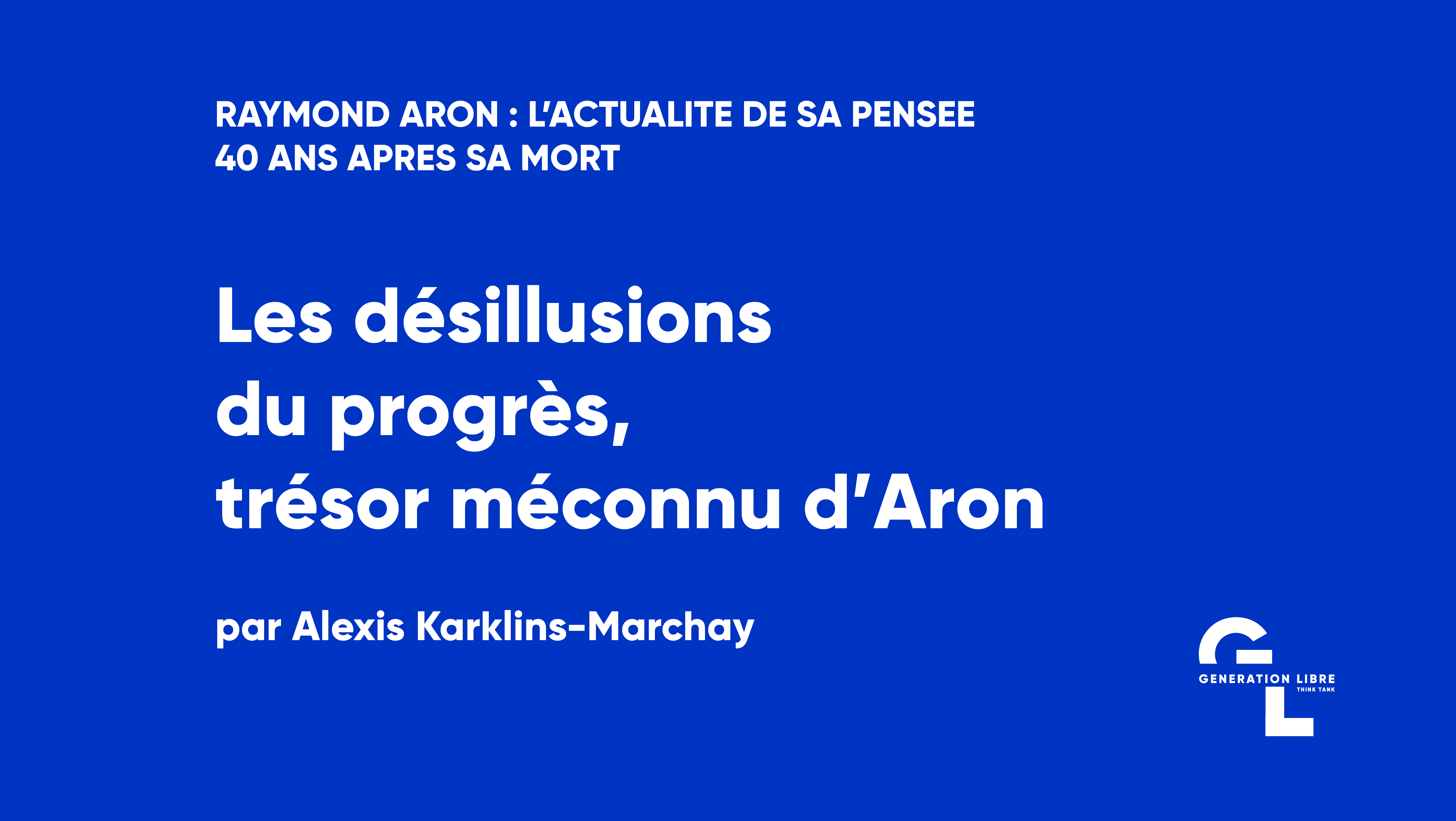
Dans sa contribution à notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Alexis Karklins-Marchay considère que notre pessimisme à l’égard des progrès fait des Désillusions une oeuvre d’actualité. Pour comprendre notre siècle, il ajoute la dialectique de l’environnement et de l’identité à celles déjà analysées par l’intellectuel (égalité, socialisation et universalité).
Le fait est connu : lire Raymond Aron est un exercice exigeant. Son style peut paraître souvent aride. Son obsession de la nuance et sa volonté d’être le plus précis possible dans les termes utilisés le conduisent à multiplier les explications. Son besoin de mettre en perspective chaque propos entraîne de nombreuses digressions, comme si le penseur craignait d’être accusé d’approximations ou d’être contredit trop aisément. Ses références à une multitude d’auteurs et de concepts nécessitent des connaissances préalables importantes.
Mais c’est aussi un exercice incroyablement stimulant tant par le caractère ambitieux des questions posées que par les constats implacables qu’il établit. Sans oublier la rigueur des raisonnements ni cette humilité constante : admettre qu’il n’est pas possible de tout expliquer, de tout prévoir.
Les Désillusions du progrès, un livre toujours d’actualité
Peu de ses ouvrages incarnent autant ces deux facettes que Les Désillusions du progrès, texte d’une grande richesse et pourtant bien moins connu que L’Opium des intellectuels, Les Étapes de la pensée sociologique ou Démocratie et totalitarisme. Sous-titré Essai sur la dialectique de la modernité, il fut publié en 1969, après avoir été initialement rédigé en version anglaise pour l’Encyclopaedia Britannica quatre ans plus tôt. Aron n’avait a priori pas prévu de sortir une version française, considérant cet essai comme insuffisamment abouti ! Mais ses élèves d’alors, conscients de l’intérêt des analyses présentées, finirent par le convaincre. A raison car ce livre constitue une contribution essentielle à la compréhension de notre époque.
La préface qu’il ajouta dans l’édition française est d’une troublante actualité. Aron repart du constat établi dans son essai initial, constat qui pourrait presque apparaître comme un paradoxe : la société moderne, ou société « de consommation », malgré notre bien-être matériel considérablement accru, continue de faire l’objet de reproches et de critiques permanentes. Certains, avec une grille d’analyse d’inspiration marxiste, lui reprochent la permanence de la pauvreté au milieu de la richesse et la persistance des inégalités. D’autres, inspirés par Jean-Jacques Rousseau, dénoncent les méfaits de la « civilisation industrielle », la destruction de la nature, l’accumulation de biens de consommation et l’aliénation des individus par les moyens modernes de communication.
Dans les deux cas, comme le titre de l’ouvrage le souligne, il existe dans nos sociétés une véritable désillusion à l’égard du monde que nous avons construit, un pessimisme diffus et une défiance à l’égard des progrès réalisés. Défiance qui se traduit par des troubles sociaux et politiques dans nos démocraties, en dépit de la croissance soutenue de l’après-guerre et de nos capacités à mieux gérer les crises économiques.
Nous étions à la fin des années 1960 lorsqu’Aron établit ces constats, mais à l’évidence, un tel climat, un tel contexte rappellent ceux d’aujourd’hui et soulèvent des questions toujours aussi pertinentes : pourquoi le développement économique suscite autant de frustrations et de troubles dans le corps social ? Comment expliquer que l’on débatte autant des inégalités même lorsqu’elles diminuent ? Pourquoi être aussi pessimistes à l’égard du progrès et de la liberté alors que jamais encore dans l’histoire, les conditions de l’émancipation et de l’affirmation de la personnalité n’avaient été aussi favorables? Pourquoi dans une société mondialisée, voyons-nous autant de personnes se réfugier dans des revendications identitaires ou religieuses ?
« Il existe dans nos sociétés une véritable désillusion à l’égard du monde que nous avons construit, un pessimisme diffus et une défiance à l’égard des progrès réalisés. »
Pour répondre à ces questions, Aron entend décomposer ce qu’il nomme « la dialectique de la modernité », précisément à l’origine de nos désillusions sur le progrès. Le terme même de dialectique renvoie à un concept en vogue chez les philosophes français de l’après-guerre, notamment chez ceux qui, comme Sartre, étudient l’évolution du régime soviétique. Mais si Aron le reprend dans son ouvrage, ce n’est pas pour à nouveau débattre de l’expérience communiste. Il s’agit cette fois de poser un regard sociologique sur les contradictions constitutives de la modernité à partir des transformations en cours dans nos sociétés occidentales.
Les trois dialectiques analysées par Aron
Pour Aron, trois dialectiques sont à l’œuvre : la « dialectique de l’égalité », en lien avec les questions de croissance économique et d’inégalités ; la « dialectique de la socialisation », en lien avec nos modes de socialisation et les rapports sociaux de classe : la « dialectique de l’universalité » enfin, en rapport avec l’horizon universaliste de nos démocraties.
La première dialectique, celle de l’égalité, naît de la contradiction partielle entre deux impératifs des sociétés modernes : d’une part, nous aspirons à produire davantage de richesses et nous nous inquiétons quand la croissance économique ralentit ; d’autre part, nous souhaitons traiter tous les membres d’une société en égaux. Mais, souligne Aron, ne commettons pas la même erreur que Tocqueville et sa confusion entre égalité sociale et égalité politique. L’ambition prométhéenne de production économique accrue et l’idéal égalitaire sont difficilement compatibles.
Car si l’égalité politique est au cœur de la citoyenneté dans nos démocraties, les inégalités dans le monde du travail, elles, sont inévitables et même intrinsèques au fonctionnement de nos économies. Evoquant la pensée schumpétérienne sur les bouleversements liés au progrès continu des sciences et des techniques, et même s’il n’évoque pas la « destruction créatrice » à proprement parler, Aron exclut toute stabilisation de notre société, celle-ci étant par essence dans un état provisoire. Pour reprendre son expression, notre économie n’est pas EN mouvement ; elle est UN mouvement par elle-même.
Aron remarque par ailleurs que chaque individu entend tirer le meilleur profit de ses propres capacités et de ses compétences pour se distinguer, en poussant le plus loin possible la logique de la distinction statutaire. La recherche du prestige social, encore plus marquée dans une société qui tend à gommer les distinctions anciennes de classes, contredit ainsi l’idéal de l’égalité.
« Si l’égalité politique est au cœur de la citoyenneté dans nos démocraties, les inégalités dans le monde du travail, elles, sont inévitables et même intrinsèques au fonctionnement de nos économies. »
Dans tous les cas, il subsistera un écart entre l’énonciation politique du principe d’égalité et la persistance d’inégalités économiques et sociales considérées comme injustes, causant ainsi de nombreuses frustrations et insatisfactions.
La deuxième dialectique analysée par Aron est celle de la sociabilisation. S’appuyant sur une thèse durkheimienne, le sociologue se demande si le malaise dont nous souffrons ne viendrait de notre anomie. Autrement dit de notre misère morale plutôt que de la « misère économique » puisque nos conditions de vie matérielle se sont considérablement améliorées depuis plusieurs décennies. Si nous avons perdu nos illusions, peut-être est-ce dû à la perte de valeurs communes ?
Comme pour la dialectique de l’égalité, celle-ci procède pour le penseur de deux aspirations contradictoires. Grâce à l’instruction pour tous, les sociétés modernes aspirent à socialiser la jeunesse, à la préparer pour répondre aux besoins de nos économies et à leur transmettre ces valeurs qui permettent la vie en collectivité. Mais dans le même temps, les inégalités en matière d’éducation et d’instructions demeurent, voire s’accroissent au profit des familles les plus aisées. Ces dernières offrent en effet à leurs enfants les conditions mentales et économiques qui les poussent à étudier davantage afin de rester en haut dans la hiérarchie de la société.
A ces déterminismes familiaux qui engendrent une véritable inégalité en matière d’instruction, viennent s’ajouter les effets psychologiques nés des développements scientifiques et techniques. « La science donne à un nombre croissant d’individus une liberté de choix jadis inconcevable », écrit Aron. L’autonomie de l’individu, le détachement vis-à-vis des formes traditionnelles d’encadrement mais aussi du travail s’amplifient dans nos sociétés. Parallèlement, les revendications nourries par l’impatience des désirs et les comparaisons envieuses contribuent à nourrir le climat d’insatisfaction rappelé plus haut. En définitive, l’idéal de l’épanouissement personnel comporte en lui-même une contradiction entre libération individuelle et adaptation à la société de masse.
La troisième et dernière dialectique est celle de l’universalité. Aron avait déjà repéré au cours des années 1960 que notre planète tendait vers une forme d’universalisme. « Pour la première fois, l’humanité vit une seule et même histoire », soutient-il dans son essai. Parmi les éléments en appui de sa thèse, il évoque notamment la création de l’ONU, l’existence d’événements comme les Jeux Olympiques, la mondialisation des échanges, l’utilisation de l’anglais comme lingua franca, la diffusion des progrès scientifiques et des techniques de production, l’homogénéisation progressive des modes de consommation ou encore les moyens de communication modernes qui conduisent inexorablement vers un monde globalisé, au moins virtuellement universel.
Pourtant, Aron observe d’autres évolutions simultanées antagonistes qui caractérisent cette dialectique de l’universalisme. Les revendications identitaires, qu’elles soient religieuses, nationalistes, régionales ou ethniques ne cessent de s’accroître. Tension et conflits locaux se multiplient, comme une forme de réponse au mouvement de mondialisation. La question des frontières et la justification du protectionnisme économique demeurent toujours très présentes dans le débat. L’idée d’un universalisme se heurte ainsi constamment aux rivalités entre États et aux affirmations nationalistes.
« L’idéal de l’épanouissement personnel comporte en lui-même une contradiction entre libération individuelle et adaptation à la société de masse. »
Les principaux enseignements d’Aron sur nos désillusions
Avec les Désillusions du progrès, ouvrage écrit pourtant il y a plus d’un demi-siècle, Aron continue d’impressionner par sa capacité à repérer les permanences de l’histoire moderne, tout en ouvrant des perspectives nouvelles qui confirment la puissance de son cadre analytique.
Comment ne pas ainsi approuver sa réflexion sur l’impossibilité d’évoluer vers une société où les critiques comme les frustrations seraient réduites ? Il nous faut accepter le fait que la tension entre l’idéal et la réalité est l’expression normale d’une civilisation dont les hommes assument la responsabilité. Comme il nous faut être lucides sur le fait que la volonté d’un ordre égalitaire et la proportionnalité des statuts aux mérites se heurtent à la pesanteur ou à la complexité de la vie économique. Malgré ou à cause de l’idéal égalitaire qu’elle proclame, notre société entretient la jalousie et les revendications, ce qui incite les individus et les groupes à se comparer toujours les uns aux autres.
Par ailleurs, la pauvreté peut d’autant moins disparaître que sa définition même varie au cours de l’histoire et que les inégalités économiques et sociales se transforment sans cesse. Il en va de même avec les inégalités entre les peuples. L’humanité restera divisée par la pluralité des volontés d’indépendance des Etats, par les inégalités relatives de développement, par les nationalismes d’essence particulariste ou par les idéologies à prétention universaliste.
La grille d’analyse proposée par Aron peut être complétée par de nouvelles dialectiques qui ont pris beaucoup d’importance au cours des dernières décennies et qui accroissent encore nos frustrations et nos désillusions. Il en va ainsi de la dialectique environnementale, sujet qui n’occupait pas les premières pages des journaux à l’époque où le penseur écrivait mais qui est devenu désormais si prégnant. D’un côté, nous avons pris conscience des dérèglements climatiques et savons que nous devons adapter nos modes de production comme nos pratiques de consommation pour y répondre. De l’autre, malgré les injonctions radicales portées par certaines voix médiatiques, nous n’entendons pas renoncer à nos standards de vie et redoutons les utopies liberticides et destructrices.
Il en est de même avec la dialectique identitaire, source de tensions multiples et de colères comme le montre la montée des populismes, notamment en occident. Nous restons attachés en principe et dans notre immense majorité aux libertés individuelles fondamentales, mais en parallèle, nous craignons de voir nos sociétés de plus en plus morcelées et fracturées. Des sociétés où les revendications identitaires et individualistes prendraient le dessus sur le sentiment de « faire nation » et sur la volonté de vivre ensemble.
A ceux qui rétorquent que la rationalité pourrait changer la donne, Aron répond de façon ferme : les sociétés ne peuvent maîtriser pleinement leur destin. Parce que les hommes d’Etat ne ressemblent pas plus au strategicus de la théorie des jeux que les consommateurs ou les entrepreneurs ne ressemblent à l’homo oeconomicus, nombres de décisions politiques s’éloigneront toujours d’une démarche rationnelle. Tant que subsistera une pluralité des acteurs étatiques aux intérêts partiellement contradictoires, notre devenir demeurera « historique ». Autrement dit, l’avenir que nous bâtirons résultera de l’œuvre de tous mais ne sera voulu par personne, ce qui le rend imprévisible et potentiellement déraisonnable.
La solution pourrait-elle venir de la planification ? Là encore, Aron est catégorique. Le plan peut certes donner l’impression de réduire la part de l’aléatoire et du hasard mais les échecs seront inévitables du fait de la complexité de nos économies, avec leurs centaines de millions de décisions individuelles prises simultanément. Les planificateurs peuvent peut-être espérer influencer et jusqu’à un certain point prévoir, mais ils seront toujours confrontés aux limites importantes de nos savoirs. Grand connaisseur du marxisme et de ses incarnations historiques, Aron ne se prive d’ailleurs pas de rappeler que l’expérience soviétique a montré les impasses et les pertes inévitables d’une planification centralisée. Le goût de la prévision et de la prospective résulte de notre ambition prométhéenne, mais nous nous heurtons à une barrière infranchissable : les hommes n’ont jamais su l’histoire qu’ils faisaient et ils ne le savent pas davantage aujourd’hui.
« L’avenir que nous bâtirons résultera de l’œuvre de tous mais ne sera voulu par personne, ce qui le rend imprévisible et potentiellement déraisonnable. »
Quant à la remise en cause de la croissance économique comme moteur de nos sociétés, Aron répond avec son sens coutumier de la nuance. Oui, économistes et moralistes ont raison de s’en prendre au fétichisme des taux de croissance et de rappeler que la répartition du produit national importe désormais peut-être autant que le volume de ce produit approximativement mesuré par ceux qu’il appelle les « spécialistes de la comptabilité ». Mais ils auraient tort d’imaginer que la croissance de ce volume n’importe plus. Car, « le risque de violence surgit, même dans les pays développés, lorsque le progrès économique s’arrête ou que les opposants mettent en question le régime politique », remarque-t-il avec justesse. Avis à tous les décroissantistes, les contempteurs de l’état de droit et les admirateurs inavoués ou assumés des régimes autocratiques !
Dès lors, puisqu’une société vouée aux changements constants ne se compare pas au passé mais se confronte à ses ambitions, soyons lucides : évoluant dans une ère technique et futuriste, nous sommes condamnés à l’insatisfaction chronique.
Restent les traductions politiques que peut avoir cet antagonisme inéluctable entre idéal des ambitions et réalité des résultats. Aron énumère plusieurs sujets sensibles, tout en faisant preuve d’un certain pessimisme. Les tensions sociales ne risquent pas de disparaître. Bien au contraire. Car, comment être certains que des Etats de centaines de millions d’hommes puissent être gouvernés selon les formes connues de la démocratie politique ? Comment le citoyen peut participer à la chose publique dans ces conditions ? Comment éviter le développement d’une bureaucratie toujours plus rationalisée et abstraite? Comment assurer la formation de chacun ? Comment éviter que des millions d’humains échappent à une « organisation de termitières », pour reprendre cette terrible expression qui n’est pas sans rappeler la pensée ordolibérale qu’il connaissait bien ? Comment retrouver des certitudes dans une société devenue à ce point sécularisée, sans vérité transcendante et ignorant le but de son propre devenir ?
Autant de questions primordiales, posées dans les années 1960 et toujours valables au XXIe siècle… des questions auxquelles il peut être difficile de répondre puisque, comme il reconnaît lui-même, « qui peut prévoir l’usage que nous ferons de notre liberté ? ». En définitive, derrière la recherche de l’abondance et la réduction des inégalités, Aron exprime une conviction fondamentale qui ne peut que nous faire réfléchir. Ni la révolution, ni la technique ne renouvelleront la condition humaine et ne modifieront cette obsession qui caractérise les humains à travers les époques : la quête du sens.
Pour lire notre recueil, cliquer ICI