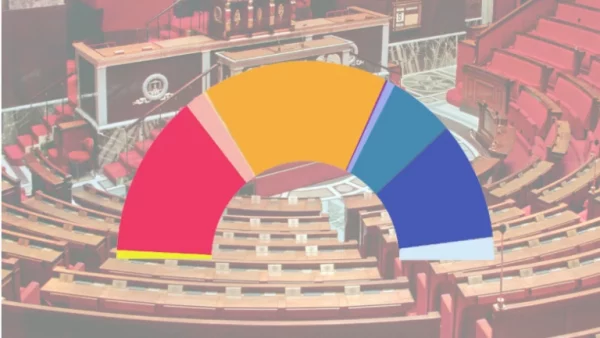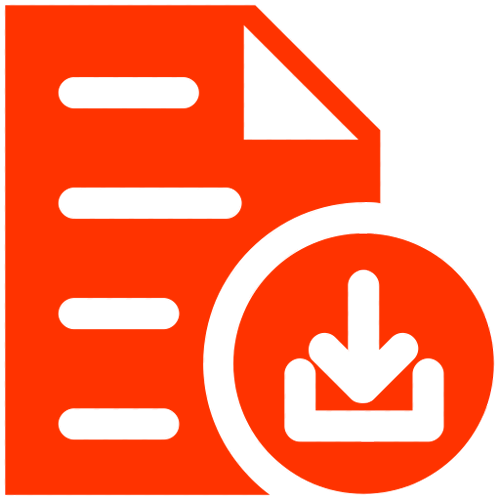Raymond Aron et la gauche

Avocat et ancien Premier ministre, il est notamment l'auteur de Ma vie avec Mauriac (2023).
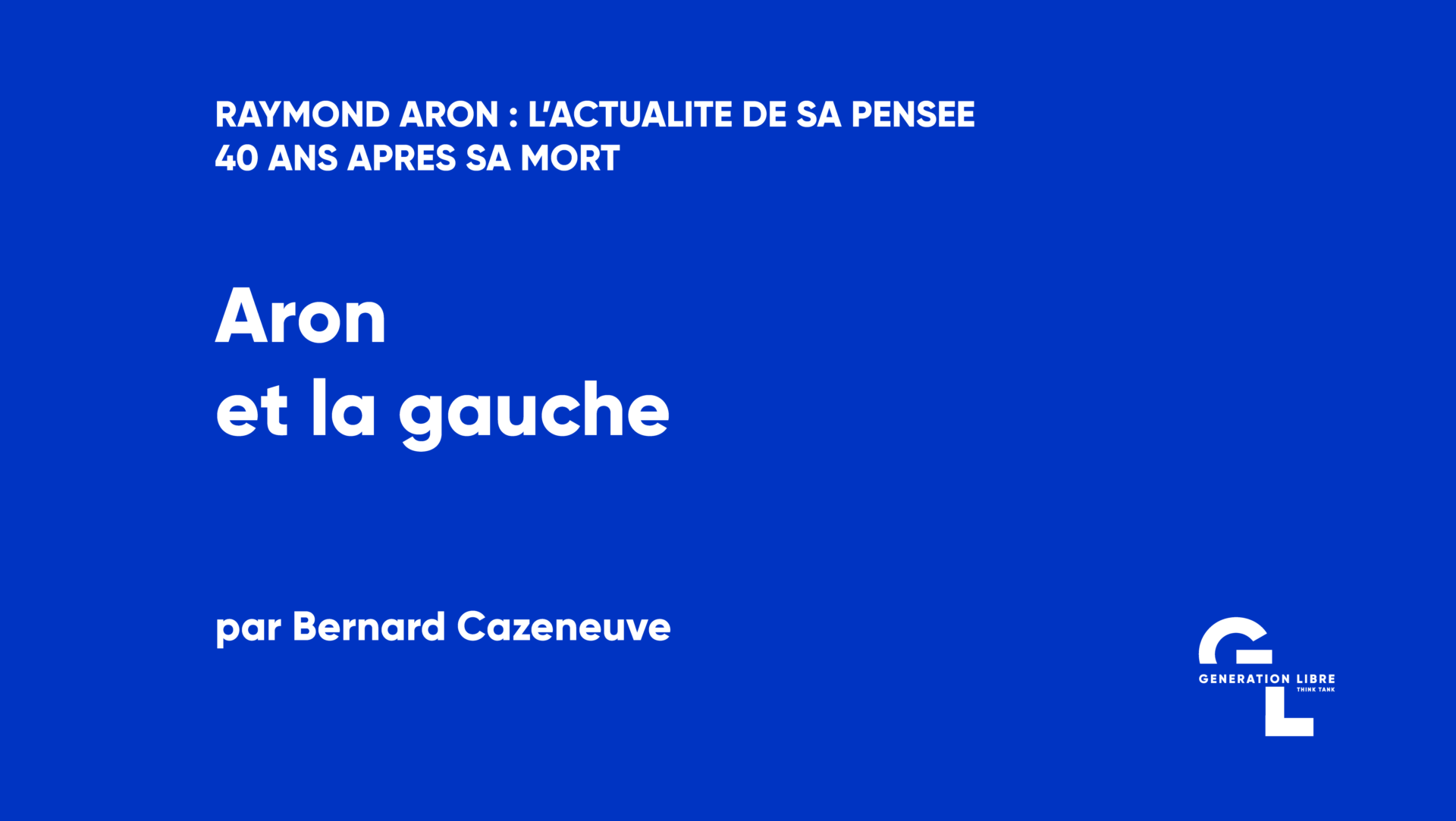
Dans un entretien pour notre recueil en hommage à Raymond Aron (le consulter ICI), Bernard Cazeneuve salue le goût de l’intellectuel pour la recherche de la vérité. L’ancien Premier ministre met notamment en lumière la rupture de Raymond Aron avec la gauche française en choisissant de dénoncer les crimes staliniens et les dérives totalitaires du communisme soviétique.
En acceptant d’écrire un article sur les relations de Raymond Aron à la gauche française, à l’invitation du think tank GenerationLibre, je savais qu’il me faudrait penser aux tragédies du siècle passé et les confronter aux idéologies qui les avaient engendrées. De la pensée de l’auteur de L’Opium des Intellectuels, j’avais surtout retenu sa filiation, qui de Montesquieu à Tocqueville, en passant par Benjamin Constant, situait Raymond Aron dans la mouvance libérale. Parmi ceux qui vénéraient Sartre et se méfiaient de Camus – dont l’esprit de nuance le rendait suspect aux yeux de certains –rares étaient ceux qui admiraient Raymond Aron. Pourtant, par sa pensée, il dominait déjà de la tête et des épaules les débats de son temps. Comme François Mauriac, il s’évertuait à plonger une torche dans les ténèbres d’une période encore fracturée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et la division du monde en deux blocs antagonistes. La publication de ses Mémoires et du Spectateur engagé, au début des années quatre-vingt, avait été pour ma génération la révélation d’une implacable exigence intellectuelle. À l’opposé de certains de ses congénères, ses analyses et ses choix l’avaient préservé des aveuglements d’une époque dominée par les idéologies. Dans les émissions audiovisuelles, où on l’interrogeait sur ses positions politiques ou sur les controverses qui l’avaient opposé aux intellectuels dominants, il racontait le processus d’excommunication dont il avait été l’objet face à ceux, qui trop longtemps, avaient exonéré le stalinisme de ses crimes et avec lesquels il avait fini par rompre.
Dans sa jeunesse studieuse à l’École normale supérieure, où de Sartre à Canguilhem, en passant par Nizan, il avait côtoyé les plus brillants esprits, Aron avait été socialiste. Mais de la montée du nazisme, observée lors de son séjour en Allemagne, entre 1930 et 1933, il avait surtout retenu la dimension possiblement tragique de l’Histoire, lorsque les passions humaines s’emparent d’elle et que la raison s’en éloigne. Loin de se détourner de la politique, il avait conçu pour le débat d’idées un intérêt qui devait le mobiliser sa vie durant. Peu à peu, on l’avait vu prendre ses distances avec le positivisme, l’idéalisme et le pacifisme de sa jeunesse, dont les conversations avec Alain l’avaient, un temps, convaincu de la pertinence. À la faveur d’une promenade sur les berges du Rhin, alors que la République de Weimar agonisait, il avait pris pour lui-même l’engagement « de connaître son époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de son savoir ». Sans céder aux facilités de la posture du spectateur, il cherchait à débusquer, en toutes circonstances, les solutions les plus praticables et jamais il ne réagissait aux choix de ceux dont il observait les agissements, sans se poser la question de ce qu’il aurait pu faire lui-même. Plus tard, interrogé sur les raisons profondes de sa prise de distance avec la gauche, il avait répondu que les intellectuels qui avaient refusé la rupture fondamentale avec le soviétisme, le communisme et le stalinisme – autrement dit avec l’autre grand totalitarisme du siècle – s’étaient éloignés des idéaux initiaux, auxquels lui, avait continué de croire. Il avait par ailleurs puisé aux sources de l’économie politique nombre d’interrogations qui le faisaient douter de la pertinence de choix qu’il jugeait peu judicieux, moins pour des raisons morales, qu’en vertu de la conception qu’il pouvait avoir de l’efficacité des politiques à mettre en œuvre.
« Amoureux de la liberté pour les autres, il la pratiquait surtout pour lui-même, en la conjuguant au courage. »
Raymond Aron était donc avant tout un anticonformiste, dont il était difficile de figer la pensée, et hasardeux de chercher à se ménager les faveurs, car tout ce qu’il exprimait, était dicté par une rigueur intellectuelle qui le singularisait. Aucun gouvernant n’était d’ailleurs parvenu à le circonvenir, pas même le général de Gaulle, auprès duquel il s’était tenu à Londres, mais dont il critiquait la politique ombrageuse d’indépendance à l’égard des États-Unis, au motif qu’elle prenait insuffisamment en compte les menaces pesant sur le monde libre. Dans un contexte où dominait la guerre froide et où l’Union soviétique imposait au continent européen un ordre totalitaire, la priorité devait aller, selon lui, à la défense absolue de la liberté et à la dénonciation d’un système qui la rendait impossible. Par la conviction que chacun devait en toute circonstance préserver son libre arbitre, il invitait au courage, sans jamais chercher à acquérir ce statut de « professeur d’hygiène intellectuelle », auquel Claude Lévi-Strauss l’avait pourtant élevé. Sa dénonciation inlassable des crimes du stalinisme, l’avait très vite opposé à Sartre et aux intellectuels qui évoluaient dans son sillage, sans que l’antitotalitarisme parvienne alors à conquérir la gauche. Il lui faudra attendre 1974 et la publication de L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne, pour sortir enfin de cet isolement qui l’avait fait tant souffrir, sans que jamais toutefois, il n’exprimât le regret de ses choix.
Au moment où Raymond Aron exerçait son magistère intellectuel et moral, on jugeait sa parole, non en fonction de ce qu’il disait, mais en raison des lieux à partir desquels il s’exprimait. Le sectarisme se nourrissait déjà de ces facilités. Plus généralement, comme il avait eu le courage, par des positions tranchées, de se distinguer de la cohorte de ceux qui s’inscrivaient dans le courant de l’idéologie dominante, il arrivait qu’il dût subir la vindicte des meutes constituées ou de leur relais dans les milieux médiatiques et universitaires. Or, la lecture de l’œuvre de Raymond Aron constituait un éloge éloquent de l’esprit de nuance, si bien que ses congénères, engagés jusqu’à l’aveuglement dans la défense du communisme et de ses régimes totalitaires, s’affrontaient à lui sans le ménager.
Sans doute Aron était-il avant tout un enfant du siècle des Lumières. La rationalité de ses démonstrations, qu’il s’intéressât à la politique ou à la sociologie, qu’il analysât la pensée de Marx, ou plus tard celle d’Émile Durkheim ou de Max Weber, puisait aux sources des philosophes qui avaient pensé les droits fondamentaux de la personne humaine et consacré l’amour irrépressible de la liberté. Face à l’absolutisme et à ses dérives, il campait du côté de la raison. Son attachement profond à l’universalisme des droits, que les penseurs marxistes considéraient comme formels, ne l’avait pas pour autant dissuadé de considérer positivement l’apport de la pensée de Karl Marx à la compréhension de l’ordre social et des rapports de domination, qui pouvaient rendre impossible la mise en œuvre effective de la liberté et de l’égalité. L’avènement du totalitarisme avait cependant contribué à conforter Aron dans l’idée que Montesquieu avait raison, lorsqu’il préconisait qu’en toute circonstance et par la disposition des choses, le pouvoir devait arrêter le pouvoir, et qu’en l’absence de séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales ne pouvaient en aucun cas être garanties. Dans une conférence prononcée en 1969, à l’occasion des Rencontres internationales de Genève, et dont la revue La Liberté et l’ordre social a reproduit le contenu, Raymond Aron précisait sa pensée en ces termes : « les droits civiques, enjeu d’une bataille intellectuellement mais non socialement gagnée, découlent de la liberté des Révolutionnaires du XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières. Ils enlèvent des libertés particulières, des privilèges à certains, pour garantir à tous les libertés qu’exige l’égalité devant la loi. Du même coup, nous découvrons à quel point les libertés dites formelles sont réelles, en ce sens qu’elles assurent à tous des garanties et des possibilités effectives. Montesquieu voyait dans la sûreté la forme première et pour ainsi dire minimale de la liberté. Or, la sûreté de l’individu exige que la liberté à la fois des personnes privées et des personnes publiques soit limitée par des règles… ». En s’inscrivant ainsi dans la filiation des philosophes des Lumières, dont la pensée avait fécondé l’universalisme des révolutionnaires français, Raymond Aron marquait son attachement à une histoire, hautement revendiquée par une partie de la gauche française, au moment de l’instauration sous la IIIe République, des libertés fondamentales.
À l’occasion de la même conférence, l’intellectuel libéral s’employait à tracer les limites des libertés dites formelles, pour épouser l’analyse critique que le courant socialiste avait pu en faire, en s’inspirant de certains des aspects de la pensée marxiste : « il ne suffit pas pour que le citoyen soit effectivement libre de faire quelque chose, que la loi interdise aux autres et à l’État de la lui interdire, sous menace de sanction, il faut encore qu’il en possède les moyens matériels ». Dans l’esprit de Raymond Aron la liberté, garantie par la loi, pouvait exiger, dans certaines circonstances, l’intervention de l’État, pour que la plupart des individus soient en situation de l’exercer vraiment. On passait ainsi imperceptiblement de la liberté négative (non-empêchement sous la menace de sanctions) à la liberté positive, se traduisant par la capacité de faire. Rien ne s’opposait donc, a priori, pour les tenants de la démocratie libérale, à ce que les individus soient dotés des moyens effectifs d’exercice de leurs libertés formelles, au terme de la reconnaissance par l’État de leurs droits économiques et sociaux. Sans doute fallait-il voir dans ce cheminement intellectuel de Raymond Aron, les raisons profondes de son adhésion de jeunesse à la pensée socialiste et l’explication du jugement positivement critique qu’il porta sur l’expérience du Front populaire.
« Sans doute Aron était-il avant tout un enfant du siècle des Lumières. »
En revanche, c’est bien l’expérience communiste, conduite notamment en Union soviétique, qui fut à l’origine de la rupture de Raymond Aron avec une partie de la gauche, c’est-à-dire l’avènement d’un État partisan, adossé à un parti unique, se fondant sur une vérité d’État. Face à cette idéologie, Raymond Aron porta plus loin le fer, avec cette clarté tranchante qui le singularisait de ceux qui refusaient de qualifier ces régimes incontestablement totalitaires pour ce qu’ils étaient : « aucun n’aurait imaginé que le socialisme se confondrait un jour, dans la théorie officiellement proclamée, avec le rôle dominant du parti, autrement dit avec l’interdiction du droit d’opposition et d’association publique. » écrivait-il.
Ainsi, l’histoire du XXe siècle avait démontré que la disparition du multipartisme et des assemblées parlementaires démocratiquement élues rendait possible le totalitarisme, sous ses multiples formes. Mais elle administrait également la preuve que la démocratie représentative, sans garantir toutes les libertés individuelles, constituait le plus solide moyen de leur préservation.
Il aura fallu le courage d’Alexandre Soljenitsyne, la mobilisation de certains intellectuels français et l’exode des boat people, au milieu des années soixante-dix, pour que Raymond Aron sorte peu à peu de son isolement et serre à nouveau la main de Jean-Paul Sartre, en juin 1979, après qu’ils eurent demandé ensemble, au président Valéry Giscard d’Estaing, d’ouvrir la possibilité de l’asile à des centaines de milliers de Vietnamiens et de Cambodgiens, fuyant le communisme. Avec l’humilité qui avait si souvent présidé à ses engagements, Raymond Aron n’entendait pas savourer sa revanche. Son tempérament et la tragédie vécue par des êtres perdus lui interdisaient d’y songer. Quant à son vieil ami Poulou (Jean-Paul Sartre) pour lequel il avait gardé estime et admiration, il expliquait sa démarche en ne reniant rien de ses combats passés, tout en donnant le sentiment de céder à une obligation morale : « Personnellement, j’ai pris parti pour des hommes qui n’étaient sans doute pas mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n’a pas d’importance, parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort… ».
« Raymond Aron était avant tout un anticonformiste, dont il était difficile de figer la pensée, et hasardeux de chercher à se ménager les faveurs. »
Il y eut donc chez Aron – comme une irrépressible exigence – la recherche permanente de la vérité. Il en paya le prix, sans ne jamais rien abandonner de ce qui lui paraissait essentiel. Le travail inlassable auquel il s’était consacré, au sortir de l’École normale supérieure, en portant sur la politique le regard du spectateur engagé, avait endurci ses convictions, sans le rendre sectaire. Alors que ses détracteurs le présentaient volontiers comme le penseur conservateur, parfois incapable de pénétrer les grands mouvements de son temps, il se trompa infiniment moins que ceux qui, à droite ou à gauche, prétendaient tout comprendre de leur époque, en s’érigeant en détenteurs de la vérité. Contre la colonisation, il prit des positions courageuses qui le firent menacer par l’extrême droite. Face à l’université, dont il percevait l’urgence de la réformer, il se montra visionnaire, sans pour autant cautionner les évènements de mai 1968, dont il ne comprit pas spontanément le sens profond. Devant le général de Gaulle, dont il soutint la plupart des choix, il garda son indépendance d’esprit en suscitant parfois jusqu’à l’exaspération du héros de la France libre. Amoureux de la liberté pour les autres, il la pratiquait surtout pour lui-même, en la conjuguant au courage. Ses relations à une gauche française, alors pétrie de certitudes, ne pouvaient qu’en être affectées, comme cela est souvent le cas des compagnons de route rigoureux et déçus, qui préfèrent la solitude au risque de devoir renoncer à eux-mêmes.
Pour lire notre recueil en intégralité, cliquer ICI